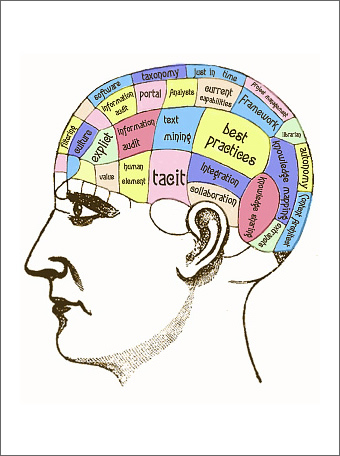
Un Specimen plus faux que nature
L’obscurantisme triomphant des neurosciences
La neuroéconomie n’a pas sa place à l’université
Une formation continue en répression urbaine (avec le sourire SVP)
Le sociologue, l’école et les pauvres
petits mâles
Le sociologue, l’école et les pauvres petits mâles
Quand les sciences sociales re-naturalisent la masculinité
mis en ligne le 19 octobre 2010
Les préjugés sexistes ont bon dos à l’Université, et ils peuvent se cacher jusque dans les productions et l’expertise scientifiques. La raison en est souvent la méconnaissance des rapports sociaux de sexe chez ceux-là mêmes dont on est en droit d’attendre un discours raisonné et argumenté à ce sujet. Un nouvel exemple vient de nous en être donné dans la presse romande, qui invite par ailleurs à réfléchir sur la pression croissante exercée sur les universitaires à intervenir sur à peu près tout et n’importe quoi.
A partir du traitement médiatico-scientifique d’un fait divers, la démonstration qui suit se veut une contribution à la déconstruction d’une problématique qui jouit depuis une dizaine d’années d’une grande portée médiatique : la prétendue « féminisation de l’école » et ses conséquences pour les garçons. D’une manière plus large, il invite à la vigilance face aux discours scientifiques, de plus en plus nombreux à l’Université de Genève et ailleurs, qui renvoient les différences entre femmes et hommes à une « nature » qui se trouve être plus idéologique que biologique.
Au hasard d’un fait divers et de l’empressement qu’il a suscité chez un professeur de sociologie de l’Université de Genève, on a pu apprendre récemment dans la presse une chose assez curieuse, à savoir qu’une baston organisée via facebook et déjouée par la police genevoise (et qui n’a donc pas eu lieu) serait le signe que « les garçons sont victimes d’une école féminisée ».
Pour comprendre comment un tel lien a pu être établi, tentons tout d’abord de synthétiser l’argumentation du professeur Sandro Cattacin tel qu’elle se dégage de l’entretien qu’il a accordé à ce sujet au journal Le Temps (28 septembre 2010, texte intégral disponible ici [pdf]) :
Pour au moins quatre raisons qui seront présentées successivement ici, cette argumentation n’est défendable ni sociologiquement, ni historiquement. Parralèlement, il peut être démontré que ce discours, loin d’être fortuit ou accidentel, s’inscrit dans un contexte historique et idéologique bien déterminé et sert des fins politiques précises.
Premièrement, le souci exprimé par le sociologue que l’école obligatoire dévirilise les garçons n’a rien de nouveau ni de spécifique à une soi-disant « féminisation » contemporaine du système scolaire (celle-ci restant d’ailleurs à démontrer). Il avait déjà été formulé il y a plus d’un siècle par bon nombre de pédagogues et de militaires, et dans un contexte où les filles ne représentaient pas une concurrence pour les garçons. La classe d’école était alors jugée amollissante pour ces derniers, dans la mesure où ils y passaient leur temps assis à recevoir passivement une instruction inculquée du haut vers le bas. En ce sens, le système scolaire – tout comme le foyer par ailleurs, marqué par une forte présence des mères – était considéré comme inadapté pour les garçons dont la supposée nature était censée être tournée vers l’extérieur, l’apprentissage sur le terrain, l’expérience pratique, la salle de classe étant jugée tout juste bonne pour les filles et pour les oisifs (les enfants de l’aristocratie en particulier). Cette forme particulière de l’anti-intellectualisme bourgeois [1] se trouve aujourd’hui réactualisée comme à l’identique dans un discours de type managérial à forte teneur masculiniste et homophobe, axé sur la nécessité pour les garçons en particulier de développer dès le plus jeune âge leur compétitivité, traduisant en cela une panique morale face au sentiment d’un danger d’effémination des garçons.
Deuxièmement, les exercices physiques auxquels il se réfère ne peuvent pas être expliqués par un argument naturaliste. Il se sont institués au sein et en marge du système scolaire à la même époque, soit au tournant des 19e et 20e siècles, sous la forme de démonstrations de force soigneusement codifiées et maîtrisées. Par conséquent, loin d’être l’expression brute d’une pulsion biologique, ces dispositions corporelles correspondent à une norme sociale historiquement située qui s’adresse aux garçons sous la forme d’une injonction à savoir se battre (ni trop, ni pas assez, sous peine d’être assimilé soit à une brute, soit à une fille ou à un efféminé) [2]. Auparavant, les représentations dominantes du « bon garçon » héritées de l’aristocratie commandaient aux jeunes hommes une plus grande retenue dans l’exercice de la force physique, en privilégiant à cette dernière l’élégance et la grâce. L’apparition des bagarres en bonne règle dans les préaux s’inscrit plus largement dans le cadre du développement des cours de gymnastique obligatoires dans les public schools anglaises, puis dans le reste de l’Europe. Il s’agit de représentations et de normes nouvelles qui se sont diffusées très progressivement au cours du 19e siècle, qui n’allaient pas de soi et ne peuvent par conséquent pas être qualifiées de naturelles. L’une des fonctions principales de la sociologie est de restituer les pseudo-évidences biologiques dans leur contexte socio-historique, et non de les asséner, ce qui a pour fonction comme on le sait de légitimer les inégalités et les différences plutôt que de les expliquer. Il est à noter que la référence à la biologie dans l’entretien est double : d’une part explicite, s’agissant des comportements des filles et des garçons censés être différents jusqu’à l’âge de 18-20 ans (fixé d’une manière totalement arbitraire), et d’autre part implicite par l’analogie animale avec les « combats de coqs » que les garçons se livrent entre eux.
Troisièmement, le fait que la codification des démonstrations de force les ait rendues moins brutales ne permet pas d’en déduire qu’elles seraient simplement de l’ordre du « ludique », comme si l’on avait affaire à des jeux innocents et sans conséquences. La « civilisation des mœurs » décrite par Norbert Elias ne doit pas se confondre avec une « société surpacifiée », puisqu’on sait aujourd’hui qu’elle s’accommode très bien de la barbarie. Dès le départ, la promotion de l’exercice physique dans les écoles, et de la gymnastique en particulier, a été vouée à des fins sociales, politiques et économiques bien déterminées (en Suisse, les cours obligatoires de gymnastique sont d’ailleurs la conséquence de pressionsémanant des milieux militaires) [3]. Leur émergence est consubstantielle d’un double souci propre à la bourgeoisie de se reproduire en tant que classe d’une part, en assurant à ses fils des perspectives de carrière dans la nouvelle donne où leur seul statut ne suffit plus à garantir leur avenir [4], et d’autre part de former de jeunes garçons jugés aptes à assumer plus tard les fonctions dirigeantes des sociétés industrielles et impériales. En bref, il s’agissait d’en faire de bons citoyens, de bons travailleurs et de bons soldats, la crainte d’un déclin de l’empire allant de paire avec celle d’une dévirilisation des garçons (c’est peut-être chez le président des Etats-Unis Theodore Roosevelt qu’on trouve l’expression la plus poussée de cette crainte) . Même s’il existait des divergences entre les élites économiques, militaires et pédagogiques quant au type exact d’exercices physiques à promouvoir (sports, gymnastique), il demeure que leur institutionnalisation et leur ritualisation obéit à une logique proprement politique qui n’est pas plus désintéressée qu’elle n’est naturelle. Maîtriser les énergies corporelles, c’est aussi les entraîner, les canaliser dans le sens qui est jugé souhaitable par les classes dirigeantes et conforme à leurs intérêts.
L’argument du « jeu », qui sera développé chez les pédagogues de l’ « éducation nouvelle » dès la fin du 19e siècle et qui trouvera son opérationnalisation la plus aboutie chez le général britannique Lord Baden-Powell, ex-combattant de la guerre des Boers et promoteur du scoutisme comme projet d’éducation informelle, masque en réalité une redoutable pression au conformisme. Celui-ci peut d’autant mieux se confondre avec l’autonomie individuelle et le progressisme social qu’il est l’aboutissement d’une une sophistication historique des rapports de pouvoir qui, à la contrainte (extérieure), substitue en partie l’autocontrainte (intériorisée). Cette injonction virile à l’autocontrainte , qui s’adressera à un nombre croissant de garçons puis de filles au 20e siècle, s’inscrit plus largement dans le processus long de développement de la maîtrise de soi étudié par Michel Foucault et dont l’enjeu clé consiste à se gouverner soi-même pour pouvoir gouverner les autres. En cela, elle participe aussi, et peut-être même avant tout, de la reproduction de la domination masculine.
Quatrièmement, il n’y a aucune raison de penser qu’il en irait différemment aujourd’hui, même si les fins politiques et militaires ont en partie changé de nature, et même si les filles sont à présent elles aussi exhortées à être compétitives sur plan de la promotion économique et sociale. Certes, les filles, toutes choses égales par ailleurs, tendent aujourd’hui à mieux réussir leur parcours scolaire que les garçons (ce qui n’autorise pas à conclure à la « féminisation » du système scolaire). Cependant, ce que le sociologue omet de préciser, c’est que cet avantage relatif ne se révèle pas payant par la suite. Au contraire même, les filles demeurent largement défavorisées par rapport aux hommes dans leurs carrières et dans leurs salaires, ainsi que dans la société en général, la structure de la domination masculine héritée de la révolution industrielle n’ayant pas été bouleversée. Or, dans tous les milieux professionnels, et de manière paradigmatique dans l’Université où il travaille, ce sont les femmes qui sont exhortées à aligner leurs comportements et leurs stratégies sur le modèle masculin, étant sous-entendu qu’elles ne seraient pas à la hauteur des hommes. C’est sur elles prioritairement que pèsent les contradictions de l’égalité. Mais lorsque ce sont les filles qui, au niveau scolaire, disposent pour une fois d’un avantage sur les garçons, cela est jugé intolérable et est l’occasion de plaindre ces derniers et, partant, les hommes en général : « On peut dès lors se demander si les hommes trouvent encore leur place à l’école s’ils n’adoptent pas le schéma féminin ». Quand bien même l’on accréditait la thèse d’un « schéma féminin » qui prédominerait dans le système scolaire, il semble inconcevable, dans cette vision idéologique du monde, que les garçons et les hommes puissent eux aussi, juste pour une fois, ajuster leurs pratiques et leurs performances sur celles des filles, entrer en compétition ouverte et réglée avec elles, un peu comme s’ils devaient traverser la Bérézina.
C’est bien la crainte millénaire de l’effémination et de la dévirilisation des garçons qui est ici à l’œuvre, et comme toujours elle a une fonction politique. Alors que c’est aux femmes qu’il est demandé de faire l’essentiel des efforts pour atteindre l’égalité, dès qu’elles gagnent une bataille, le discours dominant en vient à brandir le fantasme d’un féminisme castrateur qui serait responsable d’une féminisation de la société, de son système scolaire en particulier, et entraînerait une perte de repères chez les hommes. La voilà donc, la fonction politique de ce discours : contrer les quelques acquis des revendications féministes et des efforts entrepris par les femmes « pour rattraper leur retard » (aussi malheureuse que soit la formule). Il ne s’agit pas d’un discours isolé, puisqu’il rejoint les nombreuses revendications masculinistes sérieusement discutées et étudiées à l’heure actuelle et qui visent à transformer le système scolaire pour qu’il (re)devienne plus adapté aux soi-disant besoins des garçons.
En présentant les garçons comme ainsi dotés de besoins propres qui se distingueraient clairement de ceux des filles, le professeur Cattacin livre ici une pensée binaire et naturaliste que la sociologie s’applique à combattre depuis plus d’un siècle. Lorsqu’il prétend que les jeunes « ont une envie de sentir leur corps dans une lutte organisée en dehors des limites réglementaires », non seulement il présente le groupe des garçons comme un groupe homogène dont tous les membres auraient les mêmes besoins, mais il semble opérer, tout comme la journaliste d’ailleurs et à plusieurs reprises dans l’entretien, une réduction de la catégorie des « jeunes » à celle des « garçons », ce qui relève d’un sexisme épistémologique qu’on aurait aimé croire révolu. A la lumière des mécanismes historiques présentés ici, on comprend par ailleurs que ce discours n’énonce pas un fait étayé (un besoin objectif des garçons), mais bien une norme (une manière souhaitable d’éduquer les garçons) qui ne s’assume pas comme telle et se cache derrière les apparences de l’objectivité sociologique.
L’homogénéité du groupe des hommes n’est que l’illusion produite par les normes de masculinité qui s’adressent dans une certaine mesure à tous les garçons, mais qui ont en réalité pour principal effet d’opérer des divisions au sein du groupe. L’injonction à la maîtrise de soi a toujours eu pour effet de produire des hiérarchies entre hommes : les « vrais » hommes d’une part, idéal presque impossible à atteindre et qui correspond à celui de la classe dominante (R.W. Connell parle de « masculinité hégémonique ») ; et ceux qui servent de figures-repoussoir d’autre part, c’est-à-dire les « efféminés » ou les « brutes » qui ont commun d’être dévirilisés car manquant de maîtrise de soi. Ces hiérarchies entre hommes recoupent en bonne partie celles des différentes classes sociales (bourgeois, ouvriers, intellectuels, etc.) ou d’autres groupes sociaux (homosexuels, Juifs, colonisés, etc., qui ont en commun d’être féminisés). Nos sociétés ont atteint aujourd’hui un très haut niveau de hiérarchie entre différentes catégories sociales qui sont désormais en compétition à l’échelle de la planète, et avec une dynamique du masculin et du féminin qui est irréductible à la seule domination masculine. Dans ce contexte, l’hyper-compétition générée par le système scolaire lui-même est à elle seule productrice de tant d’inégalités qu’elle suffit à expliquer l’investissement de certains hommes – et de femmes, mais sans réel espoir de succès – dans cette ressource de pouvoir qu’est la masculinité (notamment par les démonstrations de force musculaire) et qui tient lieu de compensation relative à toutes formes de relégations sociales, mais aussi de conjuration de toutes les craintes de déchéance individuelle ou collective. Les violences qui résultent de ces manifestations gagnent alors à être comprises comme une forme de réponse à une violence structurelle qui est celle de la compétition sociale, entretenue en bonne partie par le système scolaire. Mais avant de se lancer dans des hypothèses sur les raisons qui peuvent amener des « jeunes » à organiser une rixe via Facebook, encore faudrait-il disposer de certaines données sociologiques élémentaires sur les individus en question.
Si les filles ont tout à attendre de l’école, les garçons tendent plus fréquemment à développer des stratégies de défiance voire de rébellion vis-à-vis de l’institution scolaire. Si ces stratégies peuvent procurer certains profits symboliques en termes de masculinité, elles ont pour effet paradoxalement de prétériter leur parcours scolaire. Cela ne vaut que comme tendance générale et ne permet bien évidemment pas de diviser en deux catégories homogènes les garçons et les filles, ces dernières étant également concernées par ce phénomène d’abandon. Il demeure que le décrochage scolaire des « garçons », pris en tant que catégorie fourre-tout, masque davantage d’inégalités qu’il n’en révèle et permet d’émouvoir bien davantage que l’échec scolaire récurrent des enfants des classes populaires dont l’existence semble avoir été oubliée par une partie de la sociologie elle-même.
Définir les hommes comme un groupe homogène présente enfin un avantage proprement politique : si les besoins fondamentaux censés être ceux du groupe ne sont pas satisfaits, alors la responsabilité des frustrations qui en résultent est tout naturellement à rechercher dans le groupe opposé qui est – on vous le donne en mille – les femmes (ou les féministes), virtuellement responsables de tous les maux du monde, et on sait qu’ils sont nombreux.
En définitive, la « lutte organisée en dehors des cadres réglementaires » dont parle le professeur Cattacin, si elle ne saurait correspondre à un besoin naturel et universel des hommes, a au moins une fonction qui est certaine : c’est la stratégie la plus sûre que les groupes dominants de toutes sortes, et les hommes en particulier, mettent en œuvre dans une société hautement réglementée pour assurer et reproduire leur domination. On a l’habitude de la désigner sous les termes de « réseaux », de « curriculum caché », d’« esprit de corps », etc. Entretenir la méconnaissance de ces stratégies de distinction est par ailleurs la condition qui permet de donner à croire que la réussite des dominants est due à leur mérite et non à leur statut de dominant. Une autre stratégie bien connue des dominants, qui est en fait le corrolaire de la précédente, consiste à attirer la compassion vers eux. Les hommes d’aujourd’hui excellent tout particulièrement dans cette stratégie de détournement, soutenus en cela par de nombreuses femmes, notamment en alimentant le discours très en vogue de la « crise de la masculinité », thème particulièrement prisé par les médias et qui permet de se construire ou d’entretenir une réputation à bon compte, par exemple en se lamentant sur le sort des pauvres garçons qui en sont réduits à se battre dans la rue en raison d’une prétendue « féminisation de la société ».
* * *
La boucle est ainsi bouclée, et au terme de ce long détour, on comprendra peut-être un peu mieux les conditions sociales et historiques qui ont rendu possible ce grand saut qui, en l’espace d’un entretien vite donné par un sociologue pressé à une journaliste encore plus pressée, nous a fait passer du néant (un événement qui n’a pas eu lieu) aux « garçons victimes d’une école féminisée ».
Si l’entretien qui a été analysé ici se prête particulièrement bien à une déconstruction socio-historique du fait même de sa grossièreté, il serait faux néanmoins d’en conclure que nous n’aurions affaire qu’à des propos anecdotiques pouvant être mis sur le compte de quelques hypothèses jetées en l’air à la faveur d’un égarement passager. Le procédé qui consiste à présenter les hommes comme floués dans leur nature même par une « société féminisée » s’inscrit dans un contexte académique bien précis qui peut être schématisé par trois tendances distinctes mais convergentes.
La première de ces tendances est celle du néo-naturalisme qui sévit dans les sciences depuis une vingtaine d’années. D’une grande puissance de fascination, elle puise son inspiration dans le prêt-à-penser des théories biologiques sexistes et racistes héritées de la fin du 19e siècle et remises au goût du jour à coup de subventions mirobolantes et de technologies d’imagerie cérébrale. Il en résulte un déterminisme scientiste qui conduit à attribuer à une prétendue nature, génétique le plus souvent, la cause de toutes les dispositions, de toutes les différences et de toutes les inégalités sociales, faisant ainsi l’impasse sur les acquis de plus d’un siècle d’histoire, d’anthropologie, de paléoanthropologie, de sociologie, etc. [5] L’obscurantisme triomphant des neurosciences – ou du moins de leurs composantes qui attirent l’attention de l’Etat, des entreprises et des médias – est rendu possible par la multiplication d’artefacts de laboratoire construits par des scientifiques criant Eurêka ! à chaque fois qu’une zone cérébrale quelconque s’illumine sur leurs écrans high tech. L’hégémonie de cette vision du monde est telle qu’elle parvient à produire un sens commun naturaliste qui séduit jusqu’aux sciences sociales elles-mêmes. Pourquoi d’ailleurs s’en priveraient-elles, si les sciences « dures » (donc forcément sérieuses) l’affirment avec tant de certitude ? Le fait qu’un anthropologue, Marcel Mauss, avait recommandé en 1931 déjà de considérer la division par sexes comme un fait social lourd d’enjeux et de défis pour la sociologie, n’a pas empêché un autre anthropologue, Lionel Tiger, alors que ces défis n’ont été que partiellement relevés à ce jour, de créer en avril dernier aux Etats-Unis la « Foundation for Male Studies », bien décidé à en finir une fois pour toutes avec les théories critiques des men’s studies et plus généralement des gender studies, jugées trop sociologiques et pas suffisamment biologiques.
La deuxième tendance, plus spécifique aux sciences sociales, voit s’y légitimer le concept de genre et ses usages analytiques. Un nombre croissant de chercheur·e·s s’intéressent en effet aux femmes, et depuis plus récemment aux hommes, en tant qu’êtres sexués et genrés. Dans ce cadre, une part importante de la littérature sociologique sur « la masculinité » [6] tend à se concentrer sur le phénomène dit de la « crise de la masculinité » (au singulier) ou de la souffrance des hommes (en tant qu’hommes, au sens générique du terme). L’incapacité, ou le manque de volonté, à prendre en compte l’articulation entre le genre et la classe sociale dans ces recherches, conduit presque automatiquement à désigner, explicitement ou implicitement, la catégorie bouc-émissaire de ces souffrances qui ne peut être que celle des femmes (considérée elle aussi au sens générique du terme). La fonction politique d’une telle posture épistémologique, bien qu’évidente, n’est le plus souvent pas perçue comme telle par les chercheur·e·s qui l’endossent. Ce positionnement obéit fondamentalement à une logique de distinction académique par laquelle il s’agit de se démarquer du domaine émergent des études genre, ces dernières étant jugées trop engagées, trop politiques, sans que cette critique ne soit jamais sérieusement explicitée ou argumentée. Cette délégitimation a priori d’un champ d’études, sans lequel ces problématiques n’auraient pourtant pas émergé, se fait au nom d’une lecture mythifiée du concept de « neutralité axiologique » [7]. Parce qu’ « affaire de femmes », les études genre sont ainsi soupçonnées d’entrée d’une posture partisane. Par opposition, s’intéresser (enfin) aux hommes, fût-ce sur le mode de la complainte et de la dénonciation de l’« école féminisée » et des « foyers matricentrés » qui les dénaturent, relèverait de la sociologie pure et désintéressée, rétablissant (enfin) l’ordre des choses. Or, l’enjeu d’un tel positionnement académique est politique de part en part, puisqu’une science qui défend les intérêts des groupes dominants en tenant leur discours est toujours moins susceptible d’avoir des comptes à rendre sur ses implications politiques qu’une science qui se propose de mettre ses analyses aux fins d’une émancipation sociale.
La dernière tendance est celle qui fait tout le succès des deux premières. Si les fausses évidences idéologiquement à la mode sont vite dites et facilement entendues, leur déconstruction exige un temps et un espace que la presse quotidienne n’offre pas et que les universités s’accordent de moins en moins, emboitant même le pas au rythme dicté par les médias. L’Université de Genève, en particulier, s’est dotée récemment d’un plan stratégique qui prévoit d’évaluer ses membres et ses unités en fonction notamment de leur présence dans la presse, introduisant de la sorte un nouvel enjeu de compétition dans un univers déjà très compétitif. On est en droit de se demander si cela ne constitue pas un encouragement indirect à commenter n’importe quel fait divers ou politique d’actualité et à généraliser la pratique de l’expertise à l’emporte-pièce.
Christian Schiess
[1] Christopher Forth, « La Civilisation and its Discontents : Modernity, Manhood and the Body in the Early Third Republic », in Forth, Christopher & Taithe, Bertrand, French Masculinities. History, Culture and Politics. New York & Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007 pp. 85-102.
[2] Julia Grant, « A "Real Boy" and not a Sissy : Gender, Childhood, and Masculinity, 1890-1940 », Journal of Social History, Vol.37, Nr.4, Summer 2004, pp.829-851.
[3] Marco Marcacci, « Institutionnalisation et militarisation du sport en Suisse (1914-1945) », in Busset, Thomas & Jaccoud, Christian (dir.), Sports en formes. Acteurs, contextes et dynamiques d’institutionnalisation. Lausanne : Antipodes, 2001.
[4] John Tosh, A Man’s Place. Masculinity and the Middle-Class Home in Victorian England. New Haven & London : Yale University Press, 1999.
[5] Une illustration en a été donnée dans cet article concernant les préférences de couleurs des femmes et des hommes. Un prochain texte sera consacré aux «sciences affectives».
[6] voir par exemple : Christine Castelain-Meunier, Les métamorphoses du masculin. Paris : PUF, 2005; Pascale Jamoulle, Des hommes sur le fil. La construction de l’identité masculine en milieux précaires. Paris : La Découverte, 2005; Daniel Welzer-Lang, Nous, les mecs. Essai sur le trouble actuel des hommes. Paris : Payot, 2009.
[7] Isabelle Kalinowski, Leçons wébériennes sur la science & la propagande. Marseille : Agone, 2005.