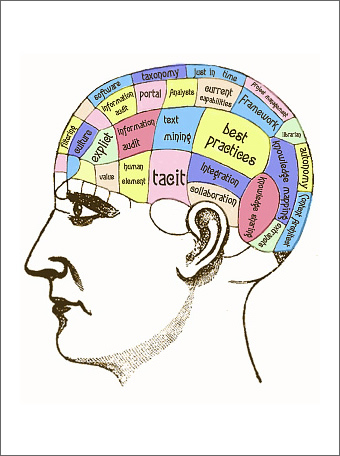
Un Specimen plus faux que nature
L’obscurantisme triomphant des neurosciences
La neuroéconomie n’a pas sa place à l’université
Une formation continue en répression urbaine (avec le sourire SVP)
Le sociologue, l’école et les pauvres
petits mâles
L’obscurantisme triomphant des neurosciences
mis en ligne le 17 novembre 2014
Ce texte, initialement publié sur le site unige-info.ch le 18 avril 2011, a été écrit en réaction à une conférence du neurobiologiste Larry Young, invité à l’Université de Genève dans le cadre de la Semaine du Cerveau. Son intervention a porté sur les effets d'une hormone – l’ocytocine – sur le comportement de souris femelles vis-à-vis de leurs progénitures, ainsi que sur les extrapolations de ces observations de laboratoire quant à l’attachement des mères humaines à leurs enfants. Les lectrices et lecteurs qui souhaitent s’informer d’une manière plus approfondie sur l’aspect extrêmement problématique d’une telle démarche pourront se référer utilement à l’article qu’Odile Fillod a consacré à cette question : Instinct maternel, science et post-féminisme.
Peut-être faites-vous partie des quelque deux mille fidèles qui se sont rendus le mardi 15 mars 2011 à la conférence de Larry J. Young [1] dans le cadre de la « Semaine du Cerveau » organisée en grandes pompes par l’Université de Genève. Preuve que l’effet d’annonce médiatique a parfaitement réussi, on pouvait y voir une foule humaine se bousculer – littéralement – pour assister à ce spectacle qui lui promettait toutes les réponses aux grandes questions de l’Amour et de la fidélité (voir le tract ci-dessous), réduites à « une mécanique neurobiologique ». Un peu plus de la moitié des personnes qui ont fait le déplacement ont pu se répartir dans les trois auditoires où la conférence était retransmise sur écrans géants, les autres ayant dû rentrer chez elles sans avoir reçu la bonne parole.
Des généralisations abusives
Cet événement a élevé à un niveau rarement égalé la portée messianique qui caractérise l’essor contemporain du champ interdisciplinaire des neurosciences. Sans aucune prudence méthodologique ou épistémologique, le professeur Young s’est attaché une heure durant à asséner la Vérité de l’Amour et de la Fidélité. Tout scientifique sérieux se doit pourtant de manipuler avec la plus grande précaution les questions à portée universelle qui lui sont adressées par les médias, par les politiciens – et par les universités elles-mêmes –, car il devrait savoir que l’on attend aujourd’hui des sciences les réponses que l’on allait auparavant chercher prioritairement à l’Eglise. La première règle de prudence qui s’impose à cet égard est de ne pas généraliser les énoncés scientifiques au-delà de ce qu’autorisent les conditions de production du fait scientifique considéré, ou du moins d’expliciter chaque étape qui permettrait de procéder à cette généralisation. Cette règle vaut pour toutes les sciences (du test de la résistance du béton en laboratoire jusqu’aux enquêtes qualitatives sur les comportements sexuels), mais est d’autant plus cruciale que l’on a affaire des discours scientifiques qui traitent de la vie sociale des individus, vie dans laquelle entrent en compte un nombre virtuellement impondérable de paramètres environnementaux. Dans de tels cas, le travail scientifique, tout comme sa « vulgarisation », consiste davantage dans l’art de poser les bonnes questions et d’y fournir des réponses circonstanciées et nuancées, que dans celui de fournir des vérités toutes faites et prêtes à l’emporter.
De cette humilité qui devrait caractériser tout travail scientifique, il était vain de chercher la moindre trace dans la conférence de Larry J. Young, comme dans une bonne partie de ce qu’on nous vend aujourd’hui sous le label de fabrique « neuro ». Les millions par lesquels l’Etat et les entreprises privées financent ces domaines ne comptent pas pour rien dans l’assurance et dans l’arrogance dont font montre les grands prêtres de la Neuroligion.
Dans le cas d’espèce, les recherches qui servent de base empirique aux énoncés du professeur Young ont été produites dans un contexte bien spécifique, celui du laboratoire, principalement sur des souris et des campagnols soumis expérimentalement aux effets d’hormones telles que la vasopressine et l’ocytocine, ainsi qu’aux gènes récepteurs de ces hormones, le but de l’opération étant de tester les causes biologiques de la monogamie ou de l’infidélité de ces rongeurs, des mâles en l’occurrence. Ces conditions spécifiques de production d’un fait scientifique opèrent déjà une réduction considérable de la complexité de la vie sociale des campagnols, vie dans laquelle, par exemple, les femelles ne sont pas anesthésiées pour les besoins d’une expérimentation.
Cette « grande conférence » de l’Université n’avait cependant pas pour fonction de nous parler des souris de laboratoire. Il eut été peu probable que les spectateurs se fussent déplacés en masse pour écouter des considérations averties sur la vie sexuelle des campagnols des prairies ou des montagnes. C’est bien de l’espèce humaine qu’il devait être question, comme en témoigne le titre de la conférence, l’illustration de l’affiche, les questions posées pour attirer le public, etc. Le public ne s’y est pas trompé, ce qui ne l’empêche pas pour autant d’avoir été trompé. Ne donnant aucune précision sur ce saut qualitatif qui lui permet de passer du comportement des rongeurs en laboratoire à la vie sociale des humains, c’est par généralisations abusives, et donc par effraction, que le conférencier a occupé le terrain de l’analyse des sociétés humaines. Par un monumental effet de structure, passé inaperçu pour des raisons idéologiques liées précisément à l’engouement que suscitent les neurosciences, il a sciemment omis de préciser l’existence de tout un ensemble de facteurs qui ont pour effet de biaiser radicalement les résultats de ses recherches dès lors qu’il prétend les appliquer aux sociétés humaines. En effet, le propre de celles-ci (comme il l’a rappelé en passant, mais sans en tirer les conclusions qui s’imposent) est d’avoir dissocié le désir sexuel de la reproduction de l’espèce, et donc d’avoir soumis le désir, la sexualité, l’amour, la fidélité, etc., à des normes sociales qui sont sans équivalent chez les autres espèces animales. Autrement dit, et pour raisonner par l’absurde, les souris n’ont pas érigé l’amour conjugal en institution, n’ont pas ordonné de curés pour faire jurer fidélité aux rongeurs, n’ont pas produit une littérature de contes de fées à destination de leurs jeunes femelles, n’ont pas jugé bon de réprimer l’homosexualité, n’ont pas besoin de pornographie pour stimuler le désir hétérosexuel de leurs mâles, n’ont pas connu de mouvements de libération sexuelle, n’ont pas eu l’idée saugrenue de tenir leurs petits dans l’ignorance des choses de la sexualité, n’ont pas la prudence élémentaire de copuler avec des préservatifs quand elles ne veulent pas se reproduire, n’ont pas mis en place de politiques natalistes ou de l’enfant unique, n’ont pas généré de hiérarchies économiques ni de règles d’héritage du patrimoine complexifiant les rapports de fidélité et d’infidélité entre les individus, et n’ont jamais estimé qu’il était préférable de payer des nourrices pour allaiter les souriceaux d’une aristocratie muridéenne en manque d’ocytocine. [2]
L'ignorance faite science
Tous ces facteurs, même s’il est difficile, voire sans doute impossible, de les faire tenir ensemble dans une analyse statistique des causes sociales de l’amour et de l’infidélité, n’en ont pas moins une conséquence certaine : L’effet propre des gènes et des hormones, quand bien même cet effet existerait indépendamment de l’environnement – et il est très improbable que tel soit le cas, même pour les maladies génétiques les mieux connues –, resterait, sauf exception pathologique, largement surdéterminé par cet environnement, au point de rendre quasi-insignifiante la causalité biologique de nos préférences et comportements socio-affectifs ordinaires. [3] Il est par ailleurs impossible de parler d’un comportement humain générique en matière de sexualité et de choix amoureux, puisque les sociétés humaines sont soumises à de très grandes variations historiques et anthropologiques, la fidélité par exemple revêtant des significations sociales et subjectives extrêmement différentes selon les époques et les cultures. De toutes ces données, que les principes épistémologiques élémentaires de la cumulativité des connaissances et de la non-contradiction imposeraient de prendre en compte, il n’a pas été question dans cette conférence. Il faut donc se plier à la conclusion qui découle logiquement de ce qui précède : le conférencier ne maîtrisait pas son sujet, et c’est donc à un ignare que l’Université de Genève a confié la mission d’informer des centaines de personnes sur les ressorts de l’amour, de la sexualité et de la fidélité.

Non seulement l’orateur semblait ne rien connaître aux nombreux apports de l’histoire et des sciences sociales en la matière, mais il s’est appliqué durant tout son spectacle à entretenir la confusion entre les conclusions qu’autorisent les recherches de laboratoire qu’il a menées et la complexité de la vie sociale humaine. [4] Alternant les images de souris en cage et de couples humains avec des enfants, enchaînant les anecdotes au sujet de la vie sexuelle des campagnols, il visait à susciter le rire, ce dernier n’étant en l’occurrence qu’une manière d’annihiler tout esprit critique chez son public, la fonction de ce procédé étant en définitive de rechercher un effet d’adhésion inconditionnelle. Le titre même de sa conférence, Science of Love and Bonding (avec des majuscules s’il vous plait), montre à quel point la stratégie adoptée ici consiste à exploiter la crédulité du public en lui promettant les réponses ultimes à des problèmes sociaux et affectifs réellement vécus par les individus et souvent générateurs de souffrances. C’est bel et bien à de la manipulation émotionnelle que l’on a affaire avec ce type de discours scientifique qui prétend décoder nos émotions.
L’attrait irrésistible de l’idéologie réductionniste
Qu’on se comprenne bien : La recherche de régularités biologiques traversant toutes les espèces animales, et unissant les sociétés humaines au-delà de leurs variations culturelles, est un objectif tout à fait légitime des sciences de la nature, et il ne saurait être question ici de les remettre en cause, tout comme il ne s’agit en aucun cas de défendre un dualisme ontologique selon lequel les faits sociaux seraient situés hors de la nature (la formidable plasticité du cerveau et le développement du cortex cérébral chez les humains en fournit la preuve biologique). Simplement, quelles que soient ces régularités biologiques, elles restent de l’ordre de la correspondance et non de la causalité mécanique. Les technologies d’imagerie cérébrales nous permettent d’observer avec toujours plus de précision ce qui se passe dans nos cerveaux lorsque nous exprimons telle ou telle émotion, nous permettent de savoir quelles hormones sont mobilisées ou sont défaillantes lorsque nous nous comportons d’une certaine manière plutôt que d’une autre, mais en aucun cas elles ne peuvent être interprétées comme la cause de faits sociaux tels que l’infidélité ou le choix d’un partenaire amoureux. C’est l’imposture majeure des neurosciences – ou pour le moins de leurs composantes les plus médiatiques bénéficiant du silence complice des autres – que de nous faire croire, à chaque fois qu’une nouvelle correspondance est identifiée, que l’on a percé le mystère de telle ou telle activité humaine, et de nous faire prendre les lorsque pour des parce que. Une zone du cerveau s’illumine-t-elle sur un écran d’ordinateur ? Voici cet artefact de laboratoire aussitôt propulsé au rang de cause ultime : le gène de ceci, l’hormone de cela. Cela est racoleur, cela est vendeur. L’Université de Genève ne s’y est pas trompée, elle qui s’est désormais spécialisée, avec son obnubilation pour les « sciences affectives », dans la mise en valeur de ce type d’impostures intellectuelles en prétendant nous expliquer par des mécanismes neuronaux des phénomènes sociaux aussi complexes que les crises financières ou l’engouement pour les compétitions de football.
Face à l’ampleur de cette propagande idéologico-scientifique, il n’est décemment plus possible de se cacher derrière l’argument qui consiste à en retourner la responsabilité à quelques chercheurs isolés ou peu scrupuleux, ni a fortiori derrière celui qui place cette responsabilité à l’extérieur du champ scientifique en déplorant la mauvaise interprétation ou les mauvais usages des résultats de la science par des citoyens ou des journalistes prétendument ignorants. Ces arguments dénotent une parfaite mauvaise foi de la part des scientifiques qui cherchent de cette manière à se placer à l’écart de toute critique sociale. Il est désormais manifeste – et cette conférence en témoigne magistralement – que les scientifiques eux-mêmes, en neurosciences tout particulièrement, jouent très explicitement du pouvoir de fascination quasi-religieuse que revêtent les gènes et les hormones, en cultivant sciemment un réductionnisme biologique dont ils savent qu’il est porteur médiatiquement et qu’il est susceptible de leur construire une réputation à bon prix. Il ne s’agit pas de quelques moutons noirs, mais d’une logique institutionnelle bien rodée qui est entretenue par le monde scientifique lui-même, et notamment par les stratégies de compétitivité qu’il génère entre chercheurs. Cette logique universitaire fonctionne si bien que les problématiques scientifiques et les questions de recherche sont de plus en plus fréquemment calibrées dès le départ en fonction de leur capacité à plaire aux médias, à l’Etat ou/et aux industries pharmaceutiques.
Neuroligion et neurobusiness
Réduire la complexité des être humains à leurs cerveaux, art dans lequel excellent les neurosciences, s’inscrit dans la continuité de la longue et triste histoire du réductionnisme biologique qui sévit depuis un siècle et demi. C’est cette même idéologie naturaliste qui a servi de base scientifique à la persécution des noirs, des femmes, des homosexuels, et qui a très activement contribué à produire du racisme, du sexisme et de l’homophobie. Les sciences ont produit, et continuent de produire sous nos yeux autant d’ignorance que de connaissance.
Avec les neurosciences contemporaines, cette ignorance a moins pour fonction de justifier l’oppression d’une catégorie spécifique d’êtres humains que de préparer chacun d’entre nous à devenir des consommateurs-zombies de drogues hormonales. L’avènement de ce consommateur docile présuppose l’annihilation de tout esprit critique, et c’est précisément ce à quoi a contribué cette conférence. L’orateur a ainsi pu conclure en exposant le public à des publicités pour des produits thérapeutiques existants ou en cours d’élaboration, allant du spray nasal générant la fidélité aux traitements hormonaux censés influencer nos choix de partenaires amoureux. Rien, durant une heure de conférence, rien n’a été fait pour favoriser le moindre esprit critique du public face à ces perspectives thérapeutiques et aux intérêts marchands qu’elles impliquent. Au contraire, toute la conférence a été délibérément construite pour conditionner l’auditoire à accepter le bien-fondé scientifique et thérapeutique de cette hégémonie pharmaceutique, en donnant à croire à l’existence d’un « gène de la fidélité » qui agirait mécaniquement sur nous et qui ne demanderait qu’à être opérationnalisé médicalement pour régler nos problèmes affectifs et sociaux.
La distance ironique qui était encore de mise chez le conférencier lorsqu’il présentait le spray hormonal censé favoriser la fidélité a cédé la place à un ton tout à fait sérieux lorsqu’il s’est appliqué à faire la promotion du Melanotan II, un traitement hormonal au double effet d’auto-bronzant et de coupe-faim, qui a la particularité de ne pas avoir été homologué en Europe et aux Etats-Unis en raison des nombreuses alertes liées à ses effets indésirables qui pourraient faire courir des risques pour la santé (ce qu’il n’a pas précisé). L’annonce n’aura cependant pas été inutile, puisque le produit est en vente sur internet, avec au titre des « effets secondaires » la remarque suivante qui s’apparente plutôt à un argument marketing détourné : « Le MT-II augmente la libido et peut occasionner des érections spontanées. Cette augmentation de libido est stable et continue pendant toute la durée de prise de Melanotan 2. ». Nous voici donc passés subrepticement de recherches sur le comportement sexuel des campagnols en laboratoire à la présentation d’un traitement hormonal non homologué mais néanmoins lucratif qui a pour but de doper les performances humaines, le tout étant justifié par la bonne cause de la lutte contre l’autisme. On n’aurait presque rien vu venir.

Si l’Université de Genève est l’organisatrice de la « Semaine du cerveau » qui se tient dans ses murs, il convient de préciser que cet événement est placé sous les auspices de la European Dana Alliance for the brain, une composante de la Dana Foundation qui est l’instigatrice de la Brain Awareness Week (BAW), manifestation internationale dans laquelle s’inscrit précisément la foire cérébrale genevoise et qui se donne pour mission la « célébration du cerveau (sic) durant toute une semaine », ainsi que d’« éduquer et d’exciter (sic) les personnes de tous âges à propos du cerveau et des recherches sur le cerveau », avec par exemple des brain-puzzles et des mindboggling coloring sheets pour les enfants. Parmi les partenaires de cette fondation qui se présente comme philanthropique, on trouve des centaines d’établissements universitaires et hospitaliers, mais aussi des associations professionnelles au rang desquelles figurent de nombreux clubs de brain-gym ou de neuro-fitness qui se proposent d’améliorer votre qualité de vie en vous offrant toute une panoplie de thérapies hormonales. On y trouve également des firmes pharmaceutiques, dont une des plus grandes d’entre elles, Eli Lilly, qui s’est illustrée en 2009 par sa condamnation « à une amende record de 1.4 milliards de dollars pour avoir encouragé la prescription de son produit hors des indications fixées » (wikipedia). Ce produit est en l’occurrence le Zyprexa, un médicament à base d’olanzapine prescrit pour traiter certaines formes de schizophrénie et dont l’un des effets secondaires est de favoriser l’obésité.
L’éducation et « l’excitation » intellectuelles des petits et des grands est décidément en de bonnes mains. Avec ce beau tableau de famille, on a alors l’étrange impression d’évoluer dans un petit monde pharmaco-médico-scientifique où des comprimés générant malencontreusement de l’obésité côtoient des injections hormonales qui vous proposent de réduire votre appétit, et où l’absence de fidélité ou d’empathie se trouve soignée hormonalement par des érections sans fin. Comme le disent si joliment les promoteurs de cette « Semaine du cerveau », cela est très « excitant ».
La neuroscience est l'opium du peuple
Il faut donc se ranger à l’évidence. Comme c’est le cas de la chaîne de télévision TF1 selon les propres mots de son ancien PDG, l’Université de Genève vend elle aussi aux entreprises pharmaceutiques du « du temps de cerveau disponible » par lequel on nous prépare, en produisant chez nous un effet de croyance scientifique dans la toute-puissance des gènes et des hormones, à être demandeurs de toutes sortes de médicaments censés soulager tous nos maux, du stress à la dépendance aux jeux d’argent en passant par la boulimie et l’infidélité. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et à satiété.
Il n’y a aucune raison de douter que ces produits pharmaceutiques produiront bel et bien un effet réel sur nous (même le placebo le fait). Cependant il n’auront pas pour conséquence de réduire nos souffrances ou de nous rendre plus heureux. C’est même le contraire qui se passera, car l’art de tout obscurantisme est de nous maintenir dans l’ignorance de ce qui cause nos souffrances dans le but de mieux continuer à nous vendre les panacées religieuses ou pharmaceutiques censées les atténuer. Ces causes sont sociales et historiques, et elles sont complexes. Se libérer des problèmes d’infidélité reviendrait non pas à administrer des médicaments, mais à se défaire de l’idéologie dont nous sommes tributaires depuis trois siècles et qui a superposé amour, conjugalité et parentalité, ce qui n’est certes pas une tâche simple. L’obscurantisme triomphant des neurosciences, en réduisant la personne humaine à son cerveau, a pour fonction politique de nous priver de nos corps, et surtout des mots et des concepts qui nous permettraient de penser et de nommer nos expériences corporelles, sociales, bref, notre être au monde. Quand il se dote de tous les moyens financiers et idéologiques qu’offrent les méthodes de propagande modernes, le réductionnisme biologique s’apparente ainsi à un totalitarisme. [5] Une célébration telle que celle qui a eu lieu dans cette « semaine du cerveau » a pour fonction de préparer le terrain de l’impérialisme médico-pharmaceutique qui est déjà notre présent et que l’avenir nous promet toujours plus hégémonique. Dans ce monde-là, le dilemme qui se pose aux universitaires est tout simplement de savoir si la science qu’ils produisent et défendent doit servir d’opium du peuple ou de moyen d’émancipation. S’il existe une théologie de la libération, rien n’empêche a priori qu’émerge une neuroscience de l’émancipation. Et si une telle science devait exister, alors il est urgent que ses praticiens sortent de leur mutisme.
Il y a quelque chose de pathétique à voir tous ces scientifiques s’effrayer du renouveau obscurantiste incarné par le courant créationniste, alors même que nombre d’entre eux participent activement de la production d’un obscurantisme qui a la particularité d’être bien plus redoutable du fait qu’il se pare de toute la légitimité de la Science et qu’il est donc susceptible d’entraîner un effet de croyance beaucoup plus fort. A quoi bon nous être défaits de nos chaînes religieuses, si c’est pour leur substituer un dogme scientiste encore plus inébranlable ? [6] Les personnes qui ont reçu une éducation religieuse et qui s’en sont départies savent bien à quel point il est difficile de douter, d’admettre qu’on doute et finalement de remettre en cause ouvertement les certitudes qu’on nous a inculquées auprès de ceux-là mêmes qui nous les ont inculquées. L’effort à fournir sera encore bien plus considérable pour se libérer du pouvoir du Clergé neuroligieux, car c’est tout le système scolaire qui nous a préparés à adhérer à leurs imbécilités et à être fascinés par leurs sermons, rendant d’autant plus élevé le coût d’une hérésie.
Tout espoir n’est cependant pas perdu, car dans la salle U600 d’Uni-Dufour où se tenait la cérémonie, plusieurs signes d’agnosticisme et même de désapprobation se manifestaient ostensiblement chez bon nombre de personnes. D’autres en revanche, dans leur Lumineuse bigoterie – telle cette personne qui a déchiré le tract distribué à l’entrée après la seule lecture de son titre –, semblent avoir abdiqué toute capacité de douter et doivent malheureusement être considérées comme définitivement perdues pour la communauté des êtres de raison. Ces ouailles auront pu bénéficier de toute l’assurance que procure le fait d’être membre de la secte deux ceux qui croient que les Gènes et les Hormones sont susceptibles de tout leur révéler de leurs existences, secte qui a trouvé en la personne de Larry J. Young son parfait gourou, déambulant sur scène à la manière d’un prédicateur, si bien qu’il était difficile de résister à la tentation de crier Alléluia ! pour acclamer chacune de ses incantations à la Déesse Ocytocine.
Christian Schiess
[1] La conférence a été annoncée sous le titre « Amour et fidélité. Une mécanique neurobiologique ? ». Le titre donné par le conférencier était « The Science of Love and Bonding : Implications for Autism ».
[2] Cette hormone a été présentée sans rire par l’orateur comme l’hormone de l’attachement de la mère à l’enfant, favorisant notamment l’allaitement. Elle a donc dû voir sa production faire un saut quantitatif très impressionnant dans les sociétés humaines avec l’essor de l’idéologie romantique au 18e siècle, et les mères de l’aristocratie française devaient en être dramatiquement dépourvues (ces dernières n’ayant pas eu la chance d’avoir à leur disposition des sprays hormonaux pour pallier cette anomalie révoltante). Le simple fait de formuler ces hypothèses est aberrant. Pour les lecteurs qui n’auraient pas assimilé l’art de la démonstration par l’absurde, précisons que cette note a pour but de mettre en l’évidence l’un des nombreux postulats moraux et idéologiques des approches neurobiologiques qui, tout en se présentant comme neutres et objectives, transposent en réalité de manière anhistorique à toutes les sociétés humaines des représentations sociales qui sont propres à la société dans laquelle évoluent les chercheurs.
[3] Pour défendre la généralisation aux humains des résultats des recherches qu’il a lui-même menées sur la « fidélité » des souris en laboratoire, l’orateur s’est fondé sur une seule et unique enquête : Hasse Valum & al, « Genetic variation in the vasopressin receptor 1a gene (AVPR1A) associates with pair-bonding behavior in humans », PNAS, vol.105, no.37, sept. 2008, pp.14153-14156. – Vérification faite, il s’agit d’une étude menée par des chercheurs d’universités suédoises et étasuniennes qui se sont intéressés aux effets de l’allèle 334 du gène codant un récepteur de la vasopressine chez une population de 552 paires de jumeaux et leurs partenaires. Parmi les hommes non-porteurs de l’allèle 334, 15% ont rapporté avoir vécu une crise conjugale ou un divorce, ce taux étant de 34% chez les porteurs de deux copies de cet allèle. Cela a conduit les chercheurs à conclure que le fait d’être homozygote pour l’allèle 334 double le risque de connaître une crise conjugale ou un divorce. Par ailleurs ces mêmes homozygotes se retrouvent deux fois plus souvent impliqués dans une relation sans être mariés (32%) que les non-porteurs de l’allèle 334 (17% de non-mariés). Quant aux femmes mariées à des hommes porteurs d’une ou deux copies de l’allèle 334, elles sont significativement plus nombreuses à rapporter une insatisfaction dans leur relation conjugale que celles mariées à un homme non-porteur de cet allèle. Si les chercheurs, relativement prudents dans leurs interprétations, se sont bien gardés de conclure à l’existence d’un « gène de la monogamie » ou d’un « gène de la fidélité » (ce que des journalistes se sont empressés de faire), leur enquête n’en souffre pas moins d’une omission fondamentale, à savoir qu’a été négligée la prise en compte de variables dont on sait pourtant qu’elles sont prépondérantes dans la détermination statistique de la formation et de la longévité probables d’un couple (revenus respectifs des époux, niveaux de formation), et qui, n’ayant pas été contrôlées ici, génèrent un fort effet de structure qui a pour conséquence que l’enquête est scientifiquement non valide. Le fait qu’un grand nombre d’enquêtes aussi grossièrement biaisées que celle-ci paraissent dans des revues scientifiques aussi prestigieuses que Science ou Nature ne doit pas nous conduire à nuancer la sévérité de notre jugement, mais doit au contraire nous inciter à reconnaître que la frontière entre science légitime et idéologie est toujours moins claire que l’on veut bien le croire. Notons encore que les auteurs de cette enquête, en prétendant tout comme le conférencier que leur recherche sur l’amour et la fidélité pourra aider à mieux comprendre l’autisme et à le soigner plus efficacement, nous livrent implicitement les présupposés normatifs qui se cachent dans leurs hypothèses de recherche, à savoir que le concubinage et l’infidélité conjugale doivent être compris comme des anomalies, voire comme le début d’une pathologie dénotant un manque d’empathie. Si l’on juxtapose ce genre d’enquêtes à celles qui continuent désespérément de rechercher l’existence d’un impossible « gène de l’homosexualité », on comprend mieux la fonction idéologique que revêtent, souvent malgré elles, les approches génétiques des comportements socio-affectifs humains.
[4] Celui-là même qui s’applique systématiquement à faire étalage de son ignorance de la complexité des relations affectives humaines a eu le privilège de se voir attribuer par la revue Nature la capacité de nous « révéler tout » sur l’Amour : « Love : Neuroscience reveals all », Nature, vol.457, January 2009, p.148.
[5] Rappelons qu’en France, il s’en est fallu de peu pour que la proposition du président Sarkozy de déceler chez les enfants dès 3 ans les gènes annonciateurs d’une future déviance ne soit acceptée. Le tollé qu’elle a suscité a conduit à l’abandon de ce projet. Nul doute que nombre de neurobiologistes, réducteurs de têtes des temps modernes, ont regretté amèrement de voir ainsi leur échapper la manne financière et le pouvoir fascinant que leur promettait cette perspective de présider à l’avenir de dizaines de milliers d’enfants.
[6] La puissance de ce dogme transparaît d’une manière particulièrement frappante dans un article publié sur le site de la Dana Foundation (l’instigatrice de la « Semaine du cerveau ») et intitulé « The Chemistry of Love ». Alors que l’auteure reconnaît dans un premier temps que 50 ans après la découverte des phéromones, aucun effet n’a pu être identifié à ce jour quant à la fonction de ces hormones sur les comportements sexuels humains, elle va ensuite s’attacher à rendre cet échec compatible avec sa représentation scientiste du monde (afin peut-être d’éviter le coût psychique d’un renoncement à ses croyances), faisant ainsi preuve de la même mauvaise foi que les créationnistes qui veulent faire entrer le monde entier dans le projet de Dieu. Pour ce faire, elle va tout simplement transformer le néant en certitude absolue : « There’s no question that something – some kind of chemical signaling that is picked up, consciously or non-consciously, by our sense of smell – influences one person’s reaction to another person. (…) There are solid clues that the same sort of chemical signals do indeed influence human reproductive physiology and behavior, although in decidedly more subtle ways than in animals. But the debate is not settled over whether these mysterious chemical cues can be called “pheromones”. » Il est vrai qu’on pourrait tout aussi bien les nommer « Dieu » ou « la Nature ». Alors que l’absence de résultats de recherche probants devrait conduire à l’humilité scientifique, au doute et à la volonté d’apprendre ce que les sciences ont produit comme connaissances anthropologiques et historiques sur la sexualité humaine, cette absence de données est interprétée ici en termes métaphysiques et conduit à redoubler la foi dans le pouvoir explicatif des hormones. Nul doute en revanche qu’à force de chercher, quelqu’un finira par trouver quelque chose, et que ce petit quelque chose nous sera révélé comme l’Hormone de la sélection sexuelle humaine.