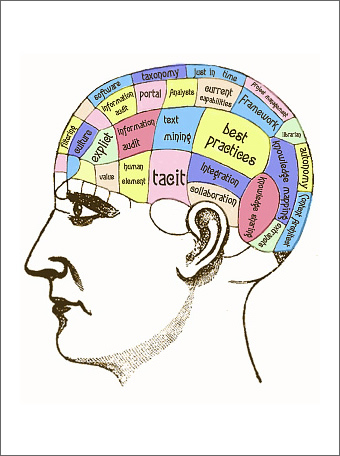
Un Specimen plus faux que nature
L’obscurantisme triomphant des neurosciences
La neuroéconomie n’a pas sa place à l’université
Une formation continue en répression urbaine (avec le sourire SVP)
Le sociologue, l’école et les pauvres
petits mâles
La neuroéconomie n’a pas sa place à l’université
mis en ligne le 17 novembre 2014
Ce texte a été initialement publié sur le site unige-info.ch le 11 décembre 2012. Il a fait l’objet ici de quelques adaptations mineures.
La politique d’« excellence » des universités consiste pour l’essentiel à s’aligner sur les dernières modes internationales à forte valeur ajoutée, sans trop réfléchir à leur pertinence scientifique et épistémologique. Voici que l’engouement pour la pop-neuroscience conduit l’Université de Genève à vouloir faire nommer un professeur de « neuro-économie » en Faculté des sciences économiques et sociales.
Si l’objectif affiché est de comprendre les « bases cérébrales » des comportements économiques, l’apport de ce type d’approche se limite en fait à ressasser une tautologie, à savoir qu’à toute activité mentale correspond une activité cérébrale, et que donc lorsque nous prenons une décision de nature économique, eh bien quelque chose se passe dans notre cerveau. Ce « quelque chose », analysé par des économistes qui n’ont une connaissance que très approximative des mécanismes neurobiologiques, est aussitôt transformé en scoop et nous est donné à voir sous la forme multicolore et bling-bling que permettent les technologies modernes d’imagerie cérébrale, dont ce type d’usage ne sert qu’à camoufler la nullité explicative de telles recherches (voir Legrenzi & Umiltà, 2011).
Pourquoi, dès lors, une telle fascination ? Le pouvoir de persuasion et l’effet de croyance propres aux approches neuroscientifiques a été analysé par deux études récentes. L’une (McCabe & Castel, 2008) a établi que l’adhésion à des énoncés non vérifiés (tels que "Regarder la télévision augmente les compétences en maths") est significativement plus forte lorsque ces énoncés sont accompagnés d’images cérébrales que lorsqu’on leur adjoint des graphiques, des tableaux ou aucune illustration. L’autre étude (Weisberg & al, 2008) a confronté trois groupes de participants à quatre types d’énoncés explicatifs de phénomènes psychologiques : L’explication correcte était formulée une fois telle quelle, et une fois avec l’ajout d’un argument neuroscientifique (fictif). L’explication incorrecte était elle aussi rédigée une fois sans, et une fois avec le même argument « neuro ». Si l’ajout de cet argument n’a pas eu d’effet sur l’adhésion à l’explication correcte, il a en revanche renforcé de manière significative l’adhésion à l’explication incorrecte. Autrement dit, une simple reformulation en termes neuroscientifiques confère une plus grande force de persuasion à une explication fausse. [1]
Or, en matière d’explications fausses, la science économique constitue déjà un réservoir inépuisable. Fondée sur une anthropologie simpliste qui réduit le comportement économique à celui de l’individu rationnel agissant dans le seul but de maximiser son propre profit, la théorie orthodoxe néo-classique a déjà contre elle les apports d’une large partie de la psychologie cognitive, de la philosophie, des sciences socio-historiques et des économistes hétérodoxes. Son hégémonie et son attrait sont dus moins à sa capacité d’expliquer les faits économiques qu’à la légitimité qu’elle apporte au système économique dominant.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que prétendent ses défenseurs, l’approche neuro-économique n’est d’aucune utilité pour critiquer ou affiner le modèle néo-classique qui domine la science économique. Il n’est nul besoin de recourir à des techniques d’imagerie cérébrale pour démolir la théorie de l’homo oeconomicus. L’adjonction d’une composante « neuro » dans cette discipline, loin de permettre de mieux comprendre les phénomènes économiques, risque au contraire d’obscurcir encore plus les causes réelles des problèmes économiques actuels. Elle ne viendra que s’ajouter à certaines composantes particulièrement fantaisistes de la science économique qui font mine d’avoir démontré que les comportements économiques n’obéissent pas qu’à une logique rationnelle mais sont en partie explicables par des facteurs émotionnels et des considérations altruistes. Sérieusement, qui, sinon les économistes eux-mêmes qui croient encore à leurs propres mystifications, peut être surpris par un tel constat ? Cela n’empêche pas certains d’entre eux de s’adonner corps et âme à ce type de « démonstration », à l’instar des recherches menées par la professeure Rajna Gibson, que le rectorat a fait nommer en grandes pompes à l’Université de Genève sous la bannière de l’« excellence ».
On pourra avoir un aperçu assez inquiétant des élucubrations de ce type dans cette interview que la professeure Gibson a donnée avec une collègue de l’Université de Zürich dans le cadre du « Salon RH » en 2009. On peut notamment y entendre ceci :
« (...) Ce que certaines études – pas seulement celle qu’on a faite – montrent, c’est que si vous avez des managers qu’on appelle "vertueux", ou avec une très forte moralité ou intégrité, ces gens-là n’ont pas besoin d’une incitation financière pour être amenés à délivrer des performances ; ils le feront juste parce qu’ils estiment que c’est correct de le faire. Donc ils n’ont pas besoin de salaires astronomiques, 30 millions, 40 millions, etc. (...) »
« (...) Ces gens qui ont une plus forte valeur sacrée de l’honnêteté sont des gens qui résistent beaucoup plus à l’appât du gain ; c’est-à-dire que même s’ils sont confrontés à une très forte pénalité en termes de salaires, ils vont quand même choisir de rester honnêtes, alors que les gens opportunistes qui ont des valeurs sacrées plus faibles vont dans un tel contexte manipuler les bénéfices. (...) »
Les traders qui s’en sont mis plein les poches avec la crise financière seront sans doute hilares à l’annonce de cette découverte, car si un test d’honnêteté de ce type leur avait été imposé par leur employeur avant l’embauche, ils auraient été assez malins pour y répondre de manière à en ressortir comme « intègres ». Mieux que quiconque peut-être, il savent bien, comme on dit, que « l’occasion fait le larron ». Il n’empêche que la prof. Gibson pourra toujours « valoriser » sa recherche en vendant le test à des banquiers qui y trouveront une occasion de plus pour redorer leur blason en attestant que tous leurs nouveaux managers sont garantis d’essence 100% vertueuse. Ajoutons à cela quelques électrodes, une bonne dose d’imagerie cérébrale et un futur poste de professeur en « neuro-éthique », et nous obtiendrons un capitalisme enfin moralisé...
L’émotion comme « biais »
La « neuro-économie » ou la « neuro-finance », pas plus que ces risibles expériences de laboratoire, ne peut se prévaloir de fournir un apport à la compréhension des mécanismes qui génèrent des crises financières ou tout autre phénomène économique. Dans ces approches soi-disant critiques de la théorie économique dominante, le facteur émotionnel, une fois prétendument identifié, est immédiatement présenté comme relevant du « biais ». Tout comme dans les recherches de la prof. Gibson, l’un des arguments avancés en faveur de l’ouverture d’un poste de professeur en « neuro-économie » est en effet qu’il devrait permettre de mieux identifier les "biais émotionnels" qui interfèrent dans les prises de décisions économiques. Or un biais, c’est fait pour être corrigé. Ces disciplines, en reposant sur le postulat que l’économie se porterait mieux si les individus agissaient d’une manière strictement rationnelle, ne proposent donc pas une correction de la théorie dominante, mais contribuent à la renforcer. Cela peut être interprété soit comme l’expression d’une grande naïveté face à la complexité du monde social, soit comme la prétention quelque peu mégalomaniaque de faire entrer le monde entier dans le cadre étroit du modèle théorique de l’homo oeconomicus, quitte à modifier nos cerveaux en conséquence (il ne faut rien exclure).
Qui sait ? Bientôt pourrons-nous peut-être compter sur le concours des neuro-économistes pour recruter les employés les plus vertueux sur la base non seulement des petits questionnaires de la prof. Gibson, mais également sur la base de la configuration de leurs cerveaux...
La « neuro-économie » a un cousin : le « neuro-marketing ». Les cadres de l’Université de Genève, ainsi que tous ceux travaillant pour l’Etat de Genève, ont pu faire sa connaissance le 5 juin dernier lors d’une conférence-formation à l’« Espace Cadres Sup » intitulée « Gagner en efficacité : Les sciences managériales au service des cadres » et censée notamment aider à « mieux gérer son cerveau et celui des autres ». Le formateur, M. Patrick M. Georges, présenté comme « professeur de management et neurochirurgien » belge, ne se cache pas de recourir à des « méthodes manipulatoires de marketing, de vente et de persuasion », prétendument fondées sur les apports des neurosciences, et d’« utiliser les faiblesses du cerveau » pour influencer clients et employés, comme on peut le lire en toutes lettres sur son blog vendreaucerveau.blogspot.com.
La formation de nos dirigeants est en de bonnes mains, et on ne saurait trop conseiller au Département des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de recruter quelques nouveaux professeurs dans ce domaine si prometteur du « neuro-marketing », lesquels pourront deviser savamment avec leurs collègues neuro-économistes et ceux qui leur donnent le change. Mais de grâce, que tous ces illuminés s’en aillent former leur secte dans une business school, et qu’on nous épargne leurs délires !
Christian Schiess
[1] Il faut préciser que l’enquête a été effectuée successivement auprès de trois groupes : des non-experts, des étudiants de 1ère année en neurosciences, et des experts formés aux neurosciences. Seul ce troisième groupe n’a pas été dupe de l’adjonction de l’argument neuro-fictif, celui-ci n’ayant pas eu d’effet sur leur (non-) adhésion à l’explication incorrecte. On ne sait pas très bien s’il faut s’en réjouir ou s’en inquiéter, puisque ce résultat laisse entendre que ce serait en toute connaissance de cause que bon nombre d’experts manipulent la crédulité du public et des étudiants qu’ils exposent à leurs « découvertes ».
Pour en savoir plus (et ne plus se faire piéger) :
LEGRENZI Paolo, UMILTÀ Carlo (2011), Neuromania. On the limits of brain science. Oxford University Press.
MCCABE David P., CASTEL Alan D. (2008), « Seeing is believing : The effect of brain images on judgments of scientific reasoning » Cognition, 107(1), 343-352.
NOË Alva (2010), Out of Our Heads : Why You Are Not Your Brain, and Other Lessons from the Biology of Consciousness. NY : Hill & Wang.
ROSE Hilary, ROSE Steven (2012), Genes, Cells and Brains : The Promethean Promises of the New Biology. London : Verso Books.
TALLIS Raymond (2011), Aping Mankind. Neuromania, Darwinitis and the Misrepresentation of Humanity. Stocksfield : Acumen Publishing.
VIDAL Catherine (2009), Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? Paris : Ed. Le Pommier.
VUL Edward, HARRIS Christine, WINKIELMAN Piotr, PASHLER Harold (2009), « Puzzling high correlations in fMRI studies of emotion, personality and social cognition », Perspectives on Psychological Science, vol.4 no.3, pp. 274-290.
WEISBERG Deena Skolnick, KEIL Frank C., GOODSTEIN Joshua, RAWSON Elizabeth, GRAY Jeremy R. (2008), « The seductive allure of neuroscience explanations ». Journal of cognitive neuroscience, 20:3, pp. 470-477.
The Neurocritic : neurocritic.blogspot.com
The Neuroskeptic : neuroskeptic.blogspot.com
Allodoxia : allodoxia.blog.lemonde.fr
Les éconoclastes : www.autisme-economie.org