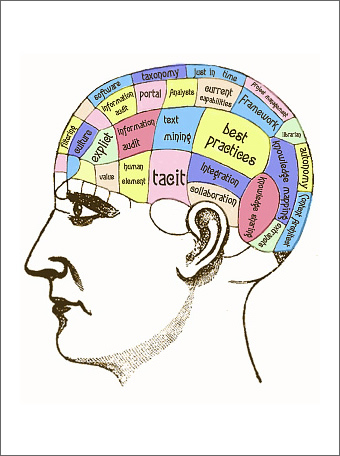
Un Specimen plus faux que nature
L’obscurantisme triomphant des neurosciences
La neuroéconomie n’a pas sa place à l’université
Une formation continue en répression urbaine (avec le sourire SVP)
Le sociologue, l’école et les pauvres
petits mâles
Du rose et du bleu
Retour sur une intox
mis en ligne le 20 octobre 2007
Le 22 août dernier, la Tribune de Genève nous livrait un bel exemple de plus du mélange déconnant que peut produire la conjonction de scientifiques un peu trop pressés et de journalistes un peu trop croyants (à moins que ce soit le contraire). C’est en page 25, ça se lit vite, mais ça se digère beaucoup plus difficilement. Ainsi, figurez-vous que si les filles préfèrent le rose et les garçons le bleu (c’est bien connu), c’est à cause de la Biologie, de l’Evolution et de nos Gènes. Et pourquoi pas de Dieu ?
Tout commence par une découverte de laboratoire. Confronté·e·s à des rectangles de couleur de huit teintes différentes, femmes et hommes manifestent leur préférence pour les teintes se rapprochant du bleu. Comme cela ne pouvait pas suffire, c’est la nuance qui est censée retenir notre attention : alors que les mâles de l’échantillon réagissent davantage aux teintes de bleu qui se rapprochent du vert, les femelles semblent plutôt apprécier les dégradations qui vont vers le rouge, c’est-à-dire en somme le violet.
Savourons d’ores et déjà cette tentative d’explication proposée par les auteures de l’article qui relate les résultats de cette étude [1] : « L’évolution doit avoir conduit les femmes à préférer les couleurs rougeâtres ». Et pourquoi ? Eh bien parce que chez les chasseurs-cueilleurs, cela aurait permis aux femmes de mieux repérer les meilleurs fruits (la pomme d’Adam et Eve, c’est bien connu, était rouge; et quant aux baies, passons sur l’injustice ainsi faite aux mûres et aux myrtilles). Tout cela pour des raisons de survie de l’espèce, bien sûr. De là à suggérer au lecteur d’aujourd’hui qu’il en va de notre survie que les garçons évitent de porter du rose, il n’y a qu’un pas que d’autres franchiront sans se faire prier. Ce pas, c’est celui de la légitimation des différences et des inégalités sociales par la science, ou plutôt par ce qu’on croît un peu rapidement être de la science.
Récapitulons. Nous sommes partis du constat que des femmes et des hommes qui se sont rendu·e·s un jour dans un laboratoire ont fait preuve d’une réactivité significativement différente à des teintes respectivement plus rougeâtres et plus verdâtres de bleu. Le monde étant ainsi fait que les chercheurs doivent justifier leurs salaires et les journalistes séduire leur lectorat à n’importe quel prix, l’histoire va se terminer par l’annonce en grandes pompes que vous avez peut-être lue dans de nombreux journaux tels que The Independant : « Les garçons aiment le bleu, les filles aiment le rose : c’est dans nos gènes » (21 août 2007). Les auteures de l’étude elles-mêmes ont dû être bien surprises par cette révélation, car nulle part dans leur article ne figurent les mots « gènes » ou « génétique ». Quant au quotidien genevois, alors qu’il n’est pas question de rose dans les résultats de l’étude, il n’hésite pas non plus à titrer : « Les filles préfèrent le rose : c’est biologique ! ». Pourtant, la journaliste semble bien avoir lu l’article en question (il fait 3 pages), car elle écrit ensuite : « La couleur favorite des deux sexes et des deux cultures reste le bleu. Ce qui n’est pas une surprise même si les chercheurs ignorent pourquoi. » Une perle ! Faut-il en déduire qu’au contraire des myrtilles, l’incohérence ne tue pas ?
Nous voici donc passés du bleu violacé au rose, des femmes aux filles et de la biologie à la génétique. On pourrait se contenter d’en déduire que ce sont les journalistes qui surinterprètent un texte scientifique qu’ils maîtrisent mal. Mais l’affaire n’est pas si simple. Non seulement les tentatives d’explications des chercheuses elles-mêmes apparaîtront pour le moins hâtives à quiconque est doté de bon sens social, mais le rose est bel et bien présent dans leur étude : il l’est non pas dans les résultats, mais dans les hypothèses de départ. L’article part du constat que les études récentes s’accordent sur une préférence universelle pour le bleu, ce qui a suscité cette surprise de la part des chercheuses : « Ce fait peut être surprenant, étant donné la prévalence et la longévité de l’idée selon laquelle les petites filles diffèrent des garçons de par leur préférence pour le rose ». L’étude part donc d’une idée de sens commun qu’elle transforme en hypothèse et, malgré qu’elle n’aboutisse à rien qui puisse nous renseigner sur le rose, laisse logiquement entendre qu’elle peut servir à corroborer cette idée selon laquelle « les petites filles préfèrent le rose ». Il est pourtant facile, sans même être neuropsychologue (mieux vaut peut-être ne pas l’être) de montrer que cette hypothèse n’a en fait pas été vérifiée et qu’elle ne peut sans doute pas l’être. Et cela pour au moins trois raisons.
La première tient à la constitution de l’échantillon. Celui-ci est formé de 208 personnes âgées de 20 à 26 ans. Or, l’énigme de départ était que « les petites filles diffèrent des garçons de par leur préférence pour le rose ». Cet énoncé peut certes se fonder sur une observation non dénuée de fondement empirique : les « petites filles » de chez nous sont bien plus souvent vêtues de rose que ne le sont les petits garçons. Quant à l’usage du terme « petite fille », il ne fait pas de doute : les chercheuses ne pouvaient se référer dans leur hypothèse qu’à des êtres femelles de bas âge, c’est-à-dire allant de la naissance jusqu’à un âge plus incertain, mais dans tous les cas bien inférieur à 20 ans qui est le plus jeune âge représenté dans l’échantillon. Les conclusions parlent d’ailleurs d’une préférence des femmes, et non des filles, pour les teintes rougeâtres de bleu. On ne peut donc rien en déduire concernant une éventuelle préférence des « petites filles » pour le rose.
La deuxième raison relève du double usage du terme de « préférence ». L’hypothèse et la conclusion de l’étude se réfèrent en fait aux usages ordinaires de ce mot, c’est-à-dire aux préférences que nous pouvons manifester dans nos pratiques quotidiennes pour telle ou telle couleur d’habits ou de papier peint. Alors que c’est ce type de préférences qu’il s’agissait d’expliquer et qui est censé avoir été démontré, la méthode scientifique mise en œuvre pour le faire procède d’un usage tout à fait différent du terme de préférence qui se réduit à la manière dont des personnes réagissent spontanément à des rectangles de couleur qui leur sont présentés sur un écran d’ordinateur. Ce second usage n’est pas à même de nous révéler quoi que ce soit sur le premier.
La troisième raison découle immédiatement des deux premières et tient également à la notion de préférence. S’il est vrai que des différences en matière de choix de couleurs s’opèrent dès la naissance d’un enfant, parler de « préférence » pour se référer au rapport des « petites filles » à la couleur rose est réducteur, ne serait-ce que parce qu’avant même que la petite fille en question n’ait pu manifester une quelconque préférence pour le rose, son entourage se sera chargé de lui attribuer le rose comme couleur de prédilection. Il s’agit donc de préférences opérées et transmises par d’autres, autrement dit de normes culturelles. Ce dernier terme sonnera sans doute comme un gros mot à l’oreille de celles et ceux qui sont un peu trop vite convaincu·e·s par ce type d’études.
Aussi scientifique soit-elle en apparence [2], l’étude en question repose ainsi sur des erreurs grossières, des évidences non remises en cause et donc sur des hypothèses bancales. Les méthodes sophistiquées et l’arsenal explicatif mobilisés pour lui donner de la crédibilité ne sont en fait qu’un énorme château de cartes qu’on cherche à bâtir sur des sables mouvants [3]. Loin d’être un cas isolé, ce canular qui n’en est (malheureusement) pas un devrait nous rendre attentifs aux présupposés idéologiques et normatifs qui se masquent bien souvent derrière l’élaboration des hypothèses de recherche des sciences dites les plus « dures ». Et les premiers à tomber dans le panneau sont bien souvent les journalistes qui n’hésitent pas, comme ici, à titrer : « Pourquoi les femmes préfèrent le rose » sans point d’interrogation, ou, mieux, comme la Tribune de Genève : « Les filles préfèrent le rose : c’est biologique ! », avec un point d’exclamation qui en dit long sur leur crédulité. L’étude en question, loin donc d’avoir été simplement mal comprise ou surinterprétée par les journalistes qui la relatent, sert en fait de trait d’union entre leur sens commun et celui des « scientifiques » pour nous conforter dans une vision du monde où les femmes et les hommes diffèrent radicalement, même si rien ne permet de le prouver.
Il serait cependant injuste de laisser entendre que les chercheuses n’ont pas cherché à prendre en compte le facteur culturel dans leur recherche. Pour ce qui est des « deux cultures » auxquelles faisait référence la journaliste plus haut, il faut savoir qu’il s’agit de la culture britannique, dont l’échantillon était constitué de 171 représentants « pure souche » (sic), auxquels les chercheurs « ont mêlé un petit groupe de Chinois » (sic). But de l’expérience ? « Exclure le facteur culturel ». Rien de moins. C’est ainsi que, par la magie de l’expérimentation neuropsychologique, nous voici propulsés du laboratoire vers nos bons vieux chasseurs-cueilleurs qui n’en demandaient pas tant, au temps d’une préhistoire qui, c’est bien connu, fut préculturelle et renferme la clé de tous les mystères de notre biologie et de notre cosmologie. Chapeau donc à nos chercheurs et à nos journalistes qui semblent bien avoir achevé la quête du Graal ! Ou plutôt des graals, parce que l’on sait désormais grâce à eux qu’il y en a deux : un bleu et un rose.
Que cette opposition du rose et du bleu trouve son origine vers la fin du 19e siècle au moment où triomphait la ségrégation sociale et économique entre les sexes ; que cette distinction par les couleurs ait été favorisée par le développement de l’industrie textile qui y trouvait une occasion de diversifier ses marchés ; que dans un premier temps des fabricants de tissus préconisaient le rose (jugé plus vif) pour les garçons et le bleu pâle (plus discret) pour les filles avant d’inverser leurs conseils pour des raisons qui restent inexpliquées et sans doute arbitraires (à moins que ce soit la revanche des gènes) ; tout cela ne semble pas perturber nos « chercheurs » qui manifestement n’ont pas envie de se salir les mains dans le fumier de l’histoire et de la science sociale. L’évaporation vers un déterminisme universel est autrement plus séduisante, conférant aux auteurs ces impostures un prestige parascientifique et une renommée personnelle que redoublera assurément la médiatisation de leurs « découvertes ». Ainsi, les conséquences de telles pratiques excèdent largement le champ scientifique, car le manque d’esprit critique dans le travail de recherche n’a d’égal que le conformisme d’une Science qui ne pose plus de questions mais assène des vérités, aussitôt relayées par des journalistes en recherche de scoops sensationnels qui toutefois ne contrarient pas trop leur lectorat. Du bleu pour les garçons. Du rose pour les filles. Il en a toujours été ainsi. Ainsi soit-il. Amen. Et dire que c’est vers cette science-là que les regards se tournent lorsqu’il s’agit de vanter l’innovation !
Christian Schiess
[1] Anya C. Hurlbert & Yazu Ling, « Biological components of sex differences in color preference », Current Biology vol.17 no.16, 2007
[2] Il faut relever ici que cette étude, qui conclut à des explications biologiques des préférences de couleur, a en fait été réalisée à partir d’observations où le rapport au biologique à proprement parler n’a pas été pris directement en considération. L’analyse se borne à vérifier la correspondance entre les préférences enregistrées et des mécanismes neuronaux, mis en évidence par ailleurs, qui nous servent à encoder les couleurs. Le lien direct n’a donc pas été établi entre les préférences observées et ce que l’on connaît du fonctionnement interne du cerveau humain. Et quand bien même un tel lien direct eût été démontré (par exemple par la correspondance entre la préférence manifestée et l’activation de la zone cérébrale concernée), il demeure que cette correspondance ne saurait être considérée comme un rapport de cause à effet entre un fait biologique et un fait social. C’est pourtant à un tel rapport de causalité naturaliste et déterministe que concluent bien souvent ce type de recherches que s’empressent de relayer les journalistes, tous deux s’étant ainsi substitués aux évêques et aux prêtres pour nous fournir le principe ultime d’explication du monde. Ce qu’une approche véritablement scientifique, c’est-à-dire non-réductionniste, permet de mettre en évidence, c’est au contraire l’effet réciproque entre la matérialité du cerveau et l’expérience sociale (comme par exemple le fait que les zones du cerveau associées à ce qu’on désigne comme le « sens de l’orientation » s’activent et se développent conjointement à certaines pratiques sociales telles que celle du football ou de la conduite de taxis). Les sciences sociales comme les sciences de la nature, chacune à leur manière et avec leurs méthodes propres, cherchent à rendre compte de ce type de phénomènes et ont élaboré à cette fin des concepts nouveaux. C’est ainsi que l’on parlera, respectivement, de constructionnisme social ou d’épigenèse du cerveau. Mais pour que les résultats de ces recherches, qui prennent la forme de vérités partielles et nuancées, parviennent jusqu’à nous, encore faudrait-il que les médias se soucient d’autre chose que de l’aspect spectaculaire des « informations » qu’ils nous transmettent.
[3] Prenons un exemple plus simple : Si on accepte sans la remettre en question la prémisse selon laquelle « Tout ce qui vit dans l’eau est un poisson », on pourra ensuite démontrer de manière parfaitement logique que la baleine est un poisson, puis débattre tout à fait rationnellement de la question de savoir de quel type de poisson il s’agit (un poisson rouge, un poisson bleu, etc.).