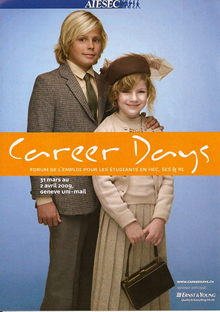Impérialisme scientifique et auto-célébration
A propos d’une conférence d’Ismail Serageldin
mis en ligne le 17 novembre 2014
Ce texte a été initialement publié sur le site unige-info.ch le 22 avril 2009, en réaction à l’intervention d’Ismail Serageldin dans le cadre des « grandes conférences » célébrant le « 450e anniversaire » de l’Université de Genève, sous le titre 450e : Retour sur la conférence d’Ismail Serageldin.
Si on nous apporte sous le titre de l’esprit quelque chose qui ne soit contenue en l’Evangile, ne le croyons pas.
Jean Calvin
Avec la conférence d’Ismail Serageldin, les festivités du « 450e » ont franchi un nouveau cap. Du pathétique, on est maintenant passé au registre de l’obscénité. Puisque la fonction de cet anniversaire est l’autocélébration à tous vents, que pouvait-on imaginer de mieux indiqué qu’un slogan simpliste et rassurant comme « La science va sauver le monde ? ». Car c’est en substance le message qu’a cherché à faire passer le directeur de la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie le 24 mars dernier, dans son discours intitulé : Réinventer les centres culturels au XXIe siècle.
Pour bien nous faire comprendre que le monde va mal, et pour nous préparer à accepter sa panacée, l’orateur n’a pas hésité à introduire sa conférence par une liturgie d’images insoutenables : enfants affamés en Afrique, cadavres mutilés dans les décombres du World Trade Center, etc. Ces images se succédaient d’une manière décontextualisée et à un rythme tel que l’on croyait assister à un journal télévisé. Ce type de manipulation émotionnelle est connu et a largement prouvé son efficacité. C’est celui qui a permis à l’administration Bush (père) de tromper le Congrès pour lui faire voter les crédits de guerre dans le Golfe persique. En 2003, c’est le même procédé qui a servi à justifier l’invasion de l’Iraq aux yeux d’une population a priori réticente. Dans le cas d’espèce, ce qu’il s’agit de justifier, c’est la mobilisation des chercheurs dans une guerre économique totale, afin de nous faire accepter des réformes soumettant les universités aux intérêts des firmes commerciales multinationales, autrement dit de nous préparer à la marchandisation du savoir. Comme nous allons le voir plus loin, l’analogie guerrière n’est pas abusive.
Un humaniste révolutionnaire
Ismail Serageldin est un humaniste. Cela a été dit et redit. Dans son mot d’introduction, le recteur Jean-Dominique Vassalli inscrit cette conférence sous le signe de l’humanisme et des « valeurs fondamentales auxquelles notre université est très profondément attachée » [1]. De même, présentant l’orateur, le professeur honoraire Charles Méla voit en lui un homme qui « unit dans ses activités et ses sujets d’étude la tradition et la modernité ; et il le fait en véritable humaniste, ouvert au dialogue des cultures. Il est aussi acteur de ce dialogue ; soucieux également de préserver et de faire partager le leg du passé et les valeurs de la civilisation. Egalement attentif aux mutations du présent, aux problématiques actuelles à l’échelle mondiale, aux ressources des technologies modernes, et également confiant dans la capacité des hommes d’œuvrer ensemble pour un avenir meilleur et capable de relever le défi du nouveau millénaire. (…) ». Suivront des mots tels que culture universelle, éthique, sagesse, etc., qui lui permettront de conclure un peu mécaniquement, et sans que l’on sache au juste pourquoi, à « l’urgence de réinventer les centres culturels du XXIe siècle ». Emphatique dans sa forme, la formule est pléonastique sur le fond. Quand deux humanistes se rencontrent, ce n’est pas le souci de précision qui l’emporte.
Du vocabulaire humaniste, le conférencier n’a pas tari : pourfendeur de l’obscurantisme, adorateur les Lumières, chantre de la tolérance, dénonciateur des misères du monde et de l’ « apartheid scientifique », promoteur de la révolution technologique, prophète de la « société de la connaissance », il identifie quatre « grands risques » en ce XXIème siècle naissant : « une mondialisation sauvage, une révolution technologique dénuée de tout humanisme, de multiples cultures qui s’attaquent mutuellement, une montée en force des conflits identitaires, de l’obscurantisme, de la xénophobie et du fanatisme ». Le symbole de la lutte contre ces fléaux, c’est bien sûr la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie, « centre des brigades des Lumières » dont il est le directeur et dont il va s’appliquer à faire l’autopromotion. Cet exercice va lui permettre de s’inscrire dans la continuité d’Aristote, d’Alexandre de Grand, de Ptolémée, de Callimaque, d’Aristarque, d’Eratosthène, d’Hipparque de Nicée, d’Euclide, d’Archimède, d’Hérophile, de Manéthon, et d’autres encore. Face à ça, le recteur Vassalli peut aller se cacher avec son austère Calvin. D’autant plus que le conférencier qui se dresse devant lui peut se targuer, sans rire, de disposer de « la loi numéro 1 de 2001 », c’est-à-dire celle qui constitue sa nouvelle bibliothèque. Celle-ci est donc née au 1er Vendémiaire de la société de la connaissance, tandis que nous, pauvres universitaires genevois, avons dû attendre un 17 mars 2009 pour nous doter d’une nouvelle loi qui nous permette enfin d’entrer dans le XXIe siècle, selon une formule chère à nos autorités académiques et politiques. Mais peu importe en définitive, puisque dans la « connivence » qui unit nos deux institutions, tous ensemble « nous honorons le passé, nous célébrons le présent, nous embrassons le futur ».
Un humaniste, ça se doit aussi de donner sa propre définition de la Culture. Pour cet humaniste-là, c’est : « mémoire et métissage ». C’est beau. Tellement beau qu’on pourrait en pleurer. C’est comme à la télé : moins on donne à réfléchir, plus on fait d’audience.
Les pauvres, ils ne connaissent rien : il faut les éduquer
Si l’on voulait synthétiser la conférence d’Ismail Serageldin, elle tiendrait dans un raisonnement de ce type : Le grand mal dont souffre le monde est l’ignorance, et celle-ci prend deux formes : le manque de sagesse qui conduit à l’intolérance, à la haine et au terrorisme ; le manque de technologies qui conduit à la misère et à la faim. Il y a donc une anthropologie du mal qui est sous-jacente à sa conception du monde. Le mal s’explique par l’absence de connaissances. A première vue pourtant, qu’y a-t-il de plus louable que de vouloir faire profiter les pauvres du monde entier du savoir et des nouvelles technologies développées par les centres de recherche et les entreprises du monde moderne, afin qu’ils accèdent au bien-être et à l’entendement ? En fait, cette posture revient à ne pas réfléchir sur les véritables causes des phénomènes qu’il déplore, lesquelles sont de nature socioéconomique et non de nature technologique et morale comme il le laisse entendre. De plus, cette même posture suppose l’idée d’une mission civilisatrice qu’une partie du monde aurait sur l’autre. En effet, dans cette vision, le progrès ne va que dans un sens. Alors qu’Ismail Serageldin prétend pourtant déconstruire les « fausses dichotomies », comme il les désigne lui-même, tout son discours est en fait construit autour de cette opposition présence/absence, modernité/tradition qui est le propre de toute pensée coloniale, mais qui est aussi au fondement des récits de la modernité qui décrivent le monde « traditionnel » sur le mode du manque. [2] Cela le dispense alors de réfléchir sur les premiers termes de ces oppositions et de questionner la modernité dans ses aspects moraux, politiques et économiques. La modernité, pour lui comme pour le recteur Vassalli, c’est nous, c’est le présent. Et comme il vient de le faire remarquer fort à propos, le présent ça se célèbre, ça ne se pense pas.
C’est toujours cette même posture surplombante qui lui permet d’asséner des contre-vérités historiques. Présentant successivement deux illustrations de paysans asiatiques, l’un représenté il y a deux mille ans, l’autre photographié aujourd’hui, il fait remarquer l’absence d’évolution entre ces deux moments qui se résument à ceci : une charrue à bœuf. Celle-ci nous est présentée comme autre chose qu’une technique, comme un manque, une absence qui attend d’être révélée à elle-même par LA technologie, symbolisée ici par la photographie d’un laboratoire de recherche agronomique moderne : « Si on n’arrive pas à faire une transformation réelle de ce savoir pour que ce soit un savoir universel qui soit acquis par par tous, on va vers un nouveau genre d’apartheid où ceux qui ont accès à la connaissance, ceux qui ont la possibilité et le pouvoir de savoir, vont laisser pour compte ceux qui ne l’ont pas. Et en même temps, même ceux qui ont toutes ces connaissances et toutes ces technologies, ont manqué de sagesse. » Notons que jamais il ne dit qui sont ces gens, ces organisations qui auraient manqué de sagesse, ni de quelle manière ils en auraient manqué. Par ailleurs, jamais il n’évoque l’hypothèse selon laquelle ce « paysan asiatique », dont il ne nous dit rien mais dont il croit connaître les besoins, pourrait, encore aujourd’hui, se nourrir à sa faim avec sa seule charrue à bœufs tandis que d’autres paysans, en Asie ou ailleurs, ayant pourtant accès des des techniques plus récentes, pourraient être expropriés de leurs terres ou privés de leurs moyens de production par des firmes commerciales voulant étendre leur hégémonie.
Une autre aberration historique réside dans la lecture qu’Ismail Serageldin propose de l’évolution des conflits armés. De manière péremptoire, voici ce qu’il affirme : « La nature même de la guerre a changé la nature du combat et fait des civils, des non-combattants – et je dis ça en connaissance de cause ici à Genève où la Croix Rouge a été fondée par Henri Dunant, là où on a parlé de l’humanitaire pour la première fois en occident – eh bien je dis qu’aujourd’hui nous perdons dix fois autant de civils à un conflit que de militaires ». Ce poncif , que l’on avait déjà pu entendre lors de la conférence de Rony Brauman, selon lequel ce ne serait qu’après la première guerre mondiale que les conflits armés auraient changé de nature et se seraient mis à faire davantage de victimes civiles que militaires, n’est possible qu’au prix d’une lecture eurocentrée de l’histoire des guerres. Il fait notamment l’impasse sur toutes les guerres coloniales, qui taisent parfois leurs noms aujourd’hui encore, et qui ont massivement tué parmi les populations civiles. En présentant les choses ainsi, on donne l’image misérabiliste d’un « tiers-monde » livré à lui-même après le retrait politique des puissances coloniales, et on légitime du même coup la nécessité post-coloniale d’une intervention humanitaire et technologique. Au secours de cette vision du monde, le conférencier projette la photographie d’un enfant-soldat congolais armé d’une mitraillette. Certes, il pose la question : « Qui leur vend des armes ? », mais s’il peut se permettre cette question, qui peut paraître impertinente de prime abord, c’est que, comme nous allons le voir maintenant, les entreprises multinationales dont Ismail Serageldin sert les intérêts sont moins celles de l’armement que celles de l’agroalimentaire et des biotechnologies.
Une « culture universelle » très particulière
Deux semaines avant sa conférence de Genève, le docteur Serageldin se trouvait à Lyon pour le forum BioVision dont il est le fondateur et le vice-président. Ce « Forum mondial des sciences de la vie » se donne pour mission de promouvoir les biotechnologies et « réunit quatre communautés (scientifique, société civile, politique et industrielle) pour confronter les points de vue, comprendre les attentes de chacun et proposer des solutions concernant les problèmes majeurs auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés (nutrition, santé, énergies, environnement, agriculture…) ».
La forme de cette rencontre est celle d’une foire commerciale, dans laquelle des firmes multinationales telles que Novartis, L’Oréal, Monsanto, Roche, Serono, Unilever, et une quarantaine d’autres s’adonnent à une opération de séduction de la « société civile » et des scientifiques. Organisée parallèlement au forum Biosquare, dont le but explicite est d’être « orienté entièrement vers le business », cette rencontre au sommet opère à la manière d’un lobby international dont la fonction est double. Il s’agit d’une part d’amener les industriels et les scientifiques à se rencontrer afin qu’ils puissent signer des contrats commerciaux ou, pour le dire plus pudiquement, qu’ils « valorisent les résultats de la recherche scientifique ». D’autre part, le forum tient lieu d’espace de propagande où des entreprises pharmaceutiques et agroalimentaires cherchent à rassurer la « société civile » face à des critiques de plus en plus largement exprimées quant aux usages des biotechnologies, et tout particulièrement des organismes génétiquement modifiés (OGM). Fer de lance de la marchandisation des savoirs, le forum Biovision/Biosquare n’en est pas moins financé majoritairement par des fonds publics, et il s’est d’ailleurs tenu en présence de la ministre Valérie Pécresse. L’événement a suscité une résistance locale et a donné lieu à une manifestation d’opposants le 9 mars, laquelle a été réprimée par la police comme le documente le site d’informations alternatives lyonnaises rebellyon.info qui consacre tout un dossier à l’événement. On y trouve également de plus amples informations sur l’organisation du forum et sur ses participants.
Au vu de ces informations, on comprend déjà un peu mieux le sens de la présence de Monsieur Serageldin dans le cadre des festivités du 450e anniversaire de l’Université de Genève, laquelle vient précisément de se doter d’une nouvelle loi qui la réorganise sur le modèle d’une entreprise privée désormais autorisée à déposer des brevets sur les résultats des recherches qui y sont produites, et à en céder les droits aux chercheurs eux-mêmes. Cette appropriation privée du profit tiré de recherches financées en majeure partie par des fonds publics répond directement aux intérêts des entreprises qui, de longue date, appelaient de leurs vœux de telles réformes. Celui qui n’hésite pas à invoquer Napoléon Bonaparte pour soutenir sa cause nous apprend ainsi que « la fonction principale des centres de la culture au XXIe siècle c’est de défendre et promouvoir les valeurs des lumières, et aussi défendre et protéger les acquis de la révolution scientifique ». Quelle signification exacte faut-il donner ici au verbe « protéger », qui apparaît hautement polysémique : S’agit-il pour le directeur de la bibliothèque d’Alexandrie d’assurer la protection matérielle des précieux documents dont il est le dépositaire ? Sans doute. S’agit-il également de protéger les résultats de la recherche scientifique, ses « acquis », par un système de brevetage ? Malheureusement, ce ne ne sont pas des questions de ce type que le public a choisi de lui poser après sa conférence.
Sa proximité avec les puissants n’empêche pas Ismail Serageldin de critiquer parfois sévérement le manque de sagesse de certains d’entre eux, comme c’est le cas notamment pour les exportateurs d’armes. En bon défenseur des marchés, il n’hésite pas non plus à critiquer les subventions aux exportations agricoles qui faussent le jeu de la libre concurrence. Il peut également défendre avec fermeté des mesures fort généreuses, comme des ordinateurs à 5 dollars pour les plus pauvres, ou la distribution gratuite de semences transgéniques qui, fait curieux, seraient selon lui des semences spécifiquement adaptées aux pauvres. [3] De même, c’est avec des mots durs qu’il dénonce la tristement célèbre firme Monsanto, dont la technologie dite « Terminator » était tellement monstrueuse qu’il ne se trouve plus personne pour défendre publiquement son usage.
Mais l’essentiel ne réside pas dans ces prises de positions en apparence vertueuses qui lui valent son titre d’humaniste et deux douzaines de doctorats honoris causa à travers le monde. Les « OGM gratuits » pour les plus pauvres ne sont que l’arbre qui cache la forêt : un gigantesque marché encore insuffisamment exploité aux yeux des multinationales biotech. La plupart des paysans qui devront recourir aux semences transgéniques brevetées seront amenés à payer des licences chaque année, et donc souvent à s’endetter. Comme l’a fait remarquer Jean Ziegler dans L’Empire de la honte, si ces semences sont certes à même d’augmenter la productivité agricole là où elle est trop faible, cela se fera avant tout pour le profit des entreprises qui les commercialisent. Quant aux quelques personnes qui pourraient en « bénéficier » gratuitement (dans un premier temps), l’effet sera de les soumettre à une dépendance économique et technologique accrue, et donc de les désapproprier de leurs moyens de production. Dans tous les cas, la panacée proposée est de nature technologique, et va toujours du nord vers le sud, alors que les problèmes à résoudre sont quant à eux de nature économique.
Défendant pour sa part le droit à la souveraineté alimentaire et la prise en compte des savoirs paysans, l’organisation non-gouvernementale GRAIN dénonce la main-mise de quelques uns sur les banques mondiales de gènes, et ce même lorsque cette centralisation se fait sous l’égide des Nations Unies. Il en va ainsi du Groupe consultatif de recherche agricole international (GCRAI), dont la fonction est d’assurer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté, et ce sous les auspices de la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Créée en 1971 par les Fondations Ford, Rockfeller et par la Banque Mondiale, ce groupe détient pour le compte de la communauté internationale un tel nombre de semences paysannes que cela lui « donne pratiquement le contrôle exclusif sur l’accès » à ces dernières : « Pour avoir accès aux semences, vous devez être intégré à tout un cadre institutionnel dont la plupart des agriculteurs dans le monde ignorent même l’existence. Dit simplement, l’ensemble de la stratégie ex situ répond aux besoins des scientifiques et non des agriculteurs. De plus, le système fonctionne sur l’hypothèse suivante : une fois que les semences des agriculteurs entrent dans une unité de stockage, elles ne leur appartiennent plus et la négociation sur les droits de propriété intellectuelle et autres droits sur ces semences est l’affaire des gouvernements et de l’industrie des semences elle-même. » Or, relève encore le GRAIN, « si les gouvernements étaient réellement intéressés par la conservation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture (…), ils laisseraient les semences entre les mains des agriculteurs locaux, avec leurs pratiques agricoles actives et innovantes, en respectant et en encourageant les droits des communautés à conserver, produire, sélectionner, échanger et vendre les semences. Mais cela ne se produira pas si les gouvernements ne remettent pas complètement en question la politique et les réglementations agricoles et n’arrêtent pas de développer en priorité l’industrialisation et d’alimenter les marchés mondiaux contrôlés par les entreprises au lieu de laisser les agriculteurs nourrir librement leurs propres communautés et pays. Cela signifie faire de la souveraineté alimentaire le fondement d’une politique agricole au lieu de continuellement pousser l’agriculture toujours plus sur la voie destructive de l’intégration au marché global dirigé par les entreprises. » [4] On le voit, la centralisation même de l’accès aux semences, telle que promue par les gouvernements, favorise leur convoitise par les entreprises commerciales.
En mai 2000, sous la présidence du même Ismail Serageldin, le GCRAI lance à Dresde le premier Forum mondial de la recherche agronomique. Celui-ci se voulait l’occasion de rassembler de manière participative tous les acteurs intéressés par la recherche agronomique et le développement. Mais ce projet fédérateur peine à masquer les intérêts des entreprises privées qui y ont imposé leur vision, comme l’atteste le compte-rendu qu’en fait Susanne Gura :
« Pendant le forum de Dresde, les discussions ont tourné autours des solutions technologiques, ignorant les questions plus fondamentales comme celles des sans-terres, l’accès et le contrôle sur les ressources naturelles, les droits des agriculteurs, et la souveraineté alimentaire. Les petits paysans (représentés par Via Campesina) se sont vus accorder la parole seulement à la dernière minute, et suite à une demande émanant des organisations de la société civile. Le Forum était censé aboutir à une Perspective commune mondiale, adoptée par tous les participants. Mais les groupes de la société civile n’ont pas pu adopter la déclaration finale, à cause des positions du Forum promouvant le génie génétique et la libéralisation du marché, dans le monde agricole, et son ouverture lourde de conséquences à l’influence du secteur privé sur la recherche agronomique publique. » [5]
Ici comme ailleurs, la privatisation rampante des ressources naturelles ne s’est pas faite sans résistances. Mais celles-ci ne comptent pas, puisque selon M. Serageldin, l’important est d’« éduquer le public » dont les craintes et les oppositions ne seront jamais que l’expression de son ignorance. Plaçant les intérêts commerciaux avant le droit des peuples à la souveraineté alimentaire, cette stratégie peut parfaitement s’accompagner de l’indignation et des vœux pieux qu’impose la posture d’humaniste : « on gaspille l’énergie, on détruit les forêts ! » ; « il faut restaurer ce que nous avons détruit ! », scandait-il durant sa conférence. Soyons certains, cela n’engage personne à rien, si ce n’est à répéter en boucle les « objectifs du millénaire » qui sont censés sauver le monde de tous ses fléaux : « C’est inadmissible, Mesdames et Messieurs, que de nos jours il y ait un milliard d’individus qui n’ont pas accès à ce droit le plus essentiel de tous les droits humains : le droit de pouvoir manger à sa faim. C’est incroyable, mais c’est vrai. » Pendant ce temps, patiemment mais sûrement, l’auteur de ces cris du cœur travaille à multiplier les « partenariats public-privé », avec pour effet de faire advenir une « société de la connaissance » fondée non plus seulement sur l’exploitation des ressources matérielles, mais sur l’expropriation des savoirs d’une partie du monde par l’autre.
La « guerre de l’eau » a bien eu lieu : il en sait quelque chose
Ce qu’il importe encore de savoir à propos de notre conférencier, c’est qu’il a été un acteur clé de la privatisation de l’eau à l’échelle planétaire. La « gestion holistique de l’eau », telle qu’il la conçoit, consiste à transformer l’eau pour en faire non pas un droit fondamental, mais – et c’est là toute la subtilité –, un besoin fondamental. [6] Un droit, ça se revendique comme un dû, tandis qu’un besoin, ça se satisfait par la consommation et ça revient donc à donner un droit au fournisseur de cet objet de consommation. Alors qu’il présidait le Global Water Partnership, Ismail Serageldin s’attachait à donner aux entreprises commerciales une place de choix aux côtés des collectivités publiques pour la gestion mondiale de l’eau, celle-ci devant être gérée comme un bien économique :
« Pour fournir une eau saine à la population, le secteur privé doit prendre la direction des opérations d’approvisionnement car celles-ci nécessitent des sommes d’argent considérables. (…) Les investissements à réaliser sont urgents et colossaux. Les gouvernements ne seront pas à même de financer cet effort. (…) nous ne prônons pas le désengagement des gouvernements, nous les encourageons seulement à confier la gestion de l’eau à des opérateurs privés, capables d’en assurer le risque économique, et ceci dans un cadre réglementaire prédéfini. Des systèmes similaires ont un peu partout été mis à l’œuvre dans les secteurs des télécommunications, des transports ou de l’énergie. (…) Le vrai problème de l’eau est effectivement un problème de rentabilité...ou d’absence actuelle de rentabilité. La solution passe de toute façon par la vérité des prix, les subventions devant se limiter aux populations les plus pauvres. » [7]
Qui sont ces « populations les plus pauvres » ? A qui revient le soin de les distinguer des populations moins pauvres qui devront acheter leur eau au prix fort directement auprès des multinationales ? Lorsqu’on confie la gestion d’une ressource aussi importante que l’eau à des entreprises dont la seule raison d’être est de faire du profit, on doit s’attendre à ce qu’elles prennent leur tâche au sérieux. Quant aux vœux pieux adressés aux gouvernements et aux collectivités locales pour qu’elles assument leur responsabilité sociale dans un tel contexte de privatisation galopante, ils ne peuvent qu’entrer en conflit avec les intérêts des firmes, à moins de postuler l’existence d’une main invisble comme semble le faire le docteur Serageldin : « Le rôle des gouvernements sera d’habiliter et de réguler, tout en protégeant l’environnement et en garantissant l’accès de l’eau aux plus pauvres grâce à des programmes de subventions précis et à l’encouragement d’actions communautaires. (…) Une des bases de cette approche est de donner pouvoir de décision à diverses associations locales, dont des associations de soutien aux femmes, aux pauvres ou aux jeunes, afin que les voix adéquates se fassent entendre au sein d’une prise de décision de type participatif. » [8]
La réalité est connue, et elle contraste dramatiquement avec ces bonnes intentions. Dans la ville bolivienne de Cochabamba, la population entre en insurrection contre l’augmentation du prix de l’eau qui a été multiplié par quatre suite à son appropriation par la multinationale étasunienne Bechtel. [9] L’ouverture du marché de l’eau dans ce pays a été l’une des conditions imposées au gouvernement par la Banque Mondiale alors qu’Ismail Serageldin (encore lui) en assurait la vice-présidence. Le mot d’ordre de la révolte était la réappropriation par les communautés locales des moyens de leur approvisionnement en eau, comme l’exprime ce communiqué du 28 janvier 2000 : « Le gouvernement bolivien préfère se conformer à ce que lui dit la Banque Mondiale plutôt que de prendre en considération ce que la population considère comme adaptée à ses besoins. C’est ça le problème de fond : qui décide concernant le présent et la destinée de la population, les ressources, le travail, les conditions de vie. Nous, au sujet de l’eau, nous voulons décider par nous même : et ceci nous l’appelons démocratie. » [10] En quelques mois, et au prix d’une répression qui s’est faite dans le sang, les insurgés signent une victoire inédite contre Bechtel qui abdique et quitte le pays en avril 2000. Cette lutte va ensuite se propager dans l’ensemble du pays pour aboutir en 2003 à la démission du président Gonzalo Sánchez. Si cette victoire n’est pas venue à bout des problèmes de gestion de l’eau, elle nous montre que lorsque les peuples se prennent en main, cela ne peut se faire sans contrecarrer les intérêts de ceux qui agissent en leur noms et prétendent savoir ce qui est bon pour eux.
Quand en 1995, Ismail Serageldin annonçait que « les guerres du XXIe siècle auront l’eau pour enjeu », phrase désormais célèbre, il énonçait en fait une prophétie autoréalisatrice, car il travaillait au même moment à faire de l’eau une marchandise rare et donc convoitée. La guerre de l’eau a donc bel et bien eu lieu, et il s’agit moins d’une savante prémonition, comme on la présente souvent, que d’une stratégie délibérément mise en œuvre par l’institution dont il était alors le vice-président, à savoir la Banque Mondiale. Comme le relève Riccardo Petrella, cette stratégie revient à consacrer la privatisation de l’eau, pour ensuite en décréter la rareté, en revendiquer la « gestion durable » et enfin prédire que c’est ainsi seulement que l’on pourra continuer à abreuver la planète. [11] Autrement dit, nous avons affaire ici à la stratégie éculée du pompier incendiaire, celle qui procure le double profit d’agir du côté des puissants tout s’adonnant à la dénonciation vertueuse des misères que leurs projets funestes ne font que renforcer.
C’est aussi ce qui permet aux participants du deuxième Forum mondial de l’eau, réunis à Kyoto en 2003 à l’instigation du Conseil mondial de l’eau présidé par Ismail Serageldin, de déclarer vouloir réduire de moitié le nombre de personnes privées d’eau potable d’ici à 2015, tout en refusant d’inclure dans la résolution finale une mention de l’eau comme droit humain fondamental. [12]
C’est ce qui permet encore d’imposer des décisions par le haut, et si nécessaire par la force, tout en donnant l’impression de favoriser une « participation large » et une vision du monde inspirée des publicités de United Colors of Benetton, comme la décrit ici une ONG : « All of the above recommendations and more are detailed in the Framework for Action, though coloured in terminology all too similar to the rhetoric traditionally used by many NGOs. Children’s crayon drawings and the many references to gender, community empowerment, and land reform, help to paint what are far-reaching proposals to expand and reinforce corporate power over the world’s water supplies in a more positive and acceptable light. » [13]
Enfin, c’est ce qui permet d’être invité en tant qu’humaniste pour célébrer les 450 ans de l’Académie de Genève, au nom d’une « culture universelle » et de la lutte contre l’« apartheid scientifique ». Le sommet de l’obscénité a sans doute été atteint au moment où l’orateur s’est offert le luxe de prononcer cette phrase qui mérite de figurer dans les annales de la pensée postcoloniale : « en général dans les pays en voie de développement, nous ressentons cette mondialisation comme un poids écrasant, un poids qui nous est imposé par des gens qui n’ont aucun intérêt dans la nature de l’humain et qui cherchent seulement des dollars ». Sans que l’auteur de ces mots ne souffre le moins du monde d’un quelconque délire schizophrénique, il s’inclut dans un « nous » qui lui permet de se poser en représentant de la partie dominée du monde, et fait comme s’il n’avait pas aussi sa place dans la forme passive qu’il utilise ensuite pour désigner ceux qui imposent leur vision du monde de manière hégémonique. La réflexivité n’est manifestement pas le propre de cet humaniste-là, qui préfère nous donner à entendre sous forme de sermon cette citation attribuée à Margaret Mead, résonnant ici comme le comble de l’autocongratulation : « Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens intellectuels et engagés puissent changer le monde ; en vérité rien d’autre n’a pu le faire ». Les autres – les incultes – pourront toujours protester : ce ne seront jamais que vaines gesticulations destinées à être au mieux dénigrées, au pire réprimées.
L’autocélébration viendra-t-elle à bout de l’autocritique ?
De la phrase de Calvin citée en épigraphe, nous sommes maintenant en mesure de tenter une reformulation qui soit adaptée à l’ambition des « centres culturels du XXIe siècle » :
Si on nous apporte sous le titre de l’esprit quelque chose qui ne serve les intérêts des puissants quels qu’ils soient, ne le croyons pas.
Nous sommes également à même de mieux comprendre le sens de cette conférence et de son inscription dans le cadre des festivités du « 450ème ». En célébrant la « participation large » et l’ « ouverture sur la cité », comme aiment à le répéter nos autorités académiques, celles-ci se dispensent de favoriser une véritable réflexion sur la fonction de l’Université dans la cité et sur la définition de cette dernière, qui ne saurait être homogène et dont les intérêts sont multiples et souvent conflictuels. La question qui n’est jamais posée, c’est de savoir au service de qui précisément est appelée à travailler l’Université, à quelles composantes de « la cité » elle est censée s’ouvrir. Cette autocélébration prend alors tout son sens au regard des transformations en cours qui réorganisent notre Université sur le modèle d’une entreprise privée au service des entreprises privées et des autres institutions qui ont suffisamment de moyens financiers pour peser sur son avenir.
Alors que l’Université prend des allures de foire commerciale, alors que ses bâtiments se remplissent de stands et autres publicités invitant les étudiants à faire la preuve rituelle de leur docilité à l’égard des firmes multinationales, on peut tenter le rapprochement entre cette mobilisation-là, telle que placardée sur les murs de l’Université, et celle de l’ « enfant-soldat » dont Ismail Serageldin nous a donné à voir la triste image.

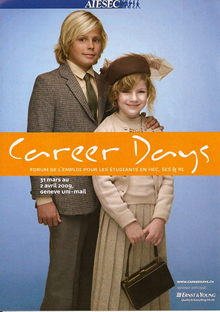
S’il ne nous avait pas soumis à un tel nombre d’images dont la seule fonction est la commisération, le conférencier aurait peut-être pu s’arrêter un instant sur celle-ci et nous poser cette question : « combien de personnes cet enfant tuera-t-il avant de se faire tuer lui-même ? ». Quant à ces deux autres enfants, si propres sur eux et si ambitieux, quel est leur futur ? Doivent-ils susciter notre amusement ou notre indignation ? En guise de protestation, une professeure a fait circuler une lettre aux membres de l’Université pour les rendre attentifs à nature non seulement sexiste, mais aryenne d’une telle représentation et du message qu’elle véhicule. Ce sont des étudiantes africaines qui le lui ont fait remarquer. Mais n’est-ce pas plus encore que cela ?
Ce que cette seconde image donne à voir, c’est la campagne de mobilisation que les grandes firmes commerciales mènent avec acharnement auprès des étudiants pour assurer leur « capacité de pouvoir mobiliser le savoir international », le « global knowledge » comme le disait si joliment l’orateur. Quand il fera son entrée à l’Université, ce garçon sera déjà passablement formaté pour répondre à leurs attentes, mais pas suffisamment encore. Le temps passé à obtenir des diplômes universitaires sera pour lui l’occasion de parfaire sa docilité, en apprenant à « se vendre » auprès d’elles. Il sera peut-être médecin. Dans ce cas, il aura appris que s’il découvre un traitement contre une maladie qui tue des milliers de personnes, il aura intérêt à le breveter immédiatement pour éviter que ce ne soient les Chinois qui le fassent avant lui, mais aussi pour son enrichissement personnel. Il sera peut-être manager, ou même trader, et dans ce cas il aura appris, avec toute la froideur rationnelle et bureaucratique qui s’impose, à ne pas sourciller lorsqu’il prendra dans son bureau des décisions stratégiques ou financières entraînant des conséquences sociales en chaîne à l’autre bout de la planète. Il sera peut-être humaniste, car plus que quiconconque avant lui, il aura entendu parler d’« éthique » à longueur de journée. Lui, il n’aura pas à affronter la souffrance de ses victimes ; il jouira d’une espérance de vie parmi les plus prometteuses. Et s’il devient quelque chose de tout cela, ce ne sera pas par manque de sagesse, mais parce qu’il aura été un pur produit de la « société de la connaissance », un bon soldat de l’« Université du XXIe siècle » dépositaire de tout le savoir légitime dont on peut rêver.
* * *
Terminons avec la vibrante conclusion qu’Ismail Serageldin a réservée à son auditoire, dans un grand élan d’humanisme version Powerpoint :
« Il existe de grandes puissances aui [sic] promouvoient [sic] la haine et la peur. Il y a ceux qui prônent L’obscurantisme, le fanatisme et la xénophobie. En Occident, aussi bien qu’en Orient. Mais : Nous, Les centres culturels de ce siècle nouveau, promoteurs des valeurs des lumières, défenseurs de l’approche scientifique : relevons le défi ! Certes, nous sommes petits face à ces courants néfastes, nous : la culture, l’esprit. Et eux, sont très grands ; l’ennemi : la haine, la force, le sabre. Mais, je vous le dis, nous allons vous surprendre. L’esprit vaincra le sabre ! »
Et le public d’applaudir à pleines mains, tel un singe auquel on vient de jeter des cacahuètes, tandis que le professeur honoraire de service remercie « infiniment » l’orateur « pour cette formidable leçon d’espoir ». Voici donc des centaines de personnes rassemblées à l’Université de Genève et s’enthousiasmant devant des propos qui sont en parfaite homologie avec les discours présidentiels de George W. Bush. Cette conclusion est en effet si manichéenne qu’elle est en constitue une insulte à l’intelligence. En présentant ainsi la science du côté du bien et l’ignorance du côté de tous les maux de la terre, M. Serageldin s’interdit, et nous interdit par là même de comprendre quoi que ce soit aux problèmes qu’il soulève. Combien de sang a-t-il été versé au nom des valeurs occidentales du progrès et de la modernité, et combien de sang coulera-t-il encore ? N’est-il pas notoire que certains terroristes parmi les plus meurtriers de ces dernières années n’étaient aucunement connus pour leur fanatisme religieux et pouvaient être éduqués comme il se doit dans des hautes écoles occidentales ? Les sciences n’ont-elles pas, elles aussi, contribué à alimenter les racismes de toutes sortes, à produire de la méconnaissance ? Aujourd’hui encore, ne concourent-elles pas, sous nos yeux, à asseoir une nouvelle forme de domination économique ? Nous avons vu que le choix même de l’orateur permettait d’éviter soigneusement que ce type de questions soient posées. L’autocélébration s’accomode mal de l’autocritique, cela est entendu. Mais nous comprenons à présent qu’elle signifie bien plus que cela : cette autocélébration-là consacre en grandes pompes l’abdication de l’esprit critique.
Vive la Science, vive l’université autonome, et que la fête soit belle !
Christian Schiess
La vidéo de la conférence et les documents projetés sont disponibles sur cette page.